26/09/2014
Pierre Le Vigan : Chronique des temps modernes
Le travail créatif contre l’aliénation par le travail
Avec Chronique des temps modernes (qui reprend et élargit en fait Le front du cachalot, paru en 2009), Pierre Le Vigan livre un ouvrage foisonnant, qui aborde une multitude de thèmes aussi bien politiques et anthropologiques que cinématographiques, littéraires et psychologiques. A travers une foule abondante de pensées, de méditations et d’aphorismes, l’auteur dresse une sorte d’inventaire critique général de la modernité. Pourtant, il ne sombre jamais dans la nostalgie pure et simple du passé ; et l’on peut même dire au contraire que l’avenir ne cesse d’éclairer le livre, comme un horizon porteur de sens, offert à qui prendrait encore la peine de se soucier de lui.
A côté de ce qui enracine, en somme, existe aussi ce qui meut. En même temps qu’un homme puise sa source dans son passé, il agit pour l’avenir. Cela fait écho en quelque sorte à la distinction opérée par Hannah Arendt entre « ce que je suis » et « qui je suis ». « Ce que (je suis), dit Pierre Le Vigan, regroupe mes appartenances, mon identité, ma provenance. Qui (je suis), c’est ce que je fais, mes actes, l’acteur que je suis : c’est moi-même en tant que je me découvre dans mon expérience. » Cette dualité parcourt à vrai dire l’ensemble de l’ouvrage, judicieusement tiraillé entre le respect pour ce dont on hérite et l’enthousiasme pour ce qu’on tente de construire. Par là, le propos d’ensemble tranche assurément avec un simple discours anti-moderne ou traditionaliste. Critiquer la modernité et respecter la tradition ne sauraient signifier qu’on momifie ce qui est mort pour le préserver tel quel dans l’éternité.
Reste que notre époque nous donne souvent de quoi nous lamenter. « La perte des repères et des normes est ce qui crée la souffrance sociale, souffrance dont ceux qui ont encore des repères sont les premières victimes. » Partout à l’entour, on peut voir les stigmates d’un monde déstructuré. Les contemporains vivent dans une sorte de chaos représentationnel, dans un nihilisme des valeurs et des émotions, qu’ils tentent péniblement de compenser par une frénésie artificielle et exaltée. Mais de tels processus de compensation ne peuvent durer qu’un temps, car, après la frénésie, vient l’épuisement. « Le rapport de l’homme au temps a changé. Les problèmes doivent être résolus instantanément. L’homme vit à flux tendu : les décisions ne peuvent être reportées. Le vécu du temps devient moins un vécu de la durée qu’un vécu de l’urgence. Cela ne vas pas sans une certaine ivresse, mais aussi sans les retombées de celle-ci : dégrisement, lassitude, épuisement. D’où des stratégies de ralentissement du temps, comme la dépression […]. » Le paradoxe est en somme que « plus les chemins de fer avancent, moins il y a de bitards », comme disait Mérimée. En d’autres termes, plus il y a de progrès, moins il y a de poésie et de joie de vivre. La modernité triomphante n’a été à bien des égards que l’aboutissement d’un long processus de déclin de la civilisation.
Cet effondrement a toutefois un nom, qui est en même temps une cause : l’économisme. Si nos repères s’étiolent, si le sens est absent, c’est en effet que nous nous abîmons purement et simplement dans le matérialisme économique, qui nous fait oublier la dimension proprement existentielle de notre être. « Selon Bernard Stiegler, la société de consommation tue la capacité de s’aimer soi-même. Elle noie chacun dans une foule fascinée et sidérée par les objets et empêche les constructions d’identités propres à chacun. En annulant le rôle des environnements proches, la société de consommation prive chacun de passé tout comme d’avenir, et nous met dans un état d’absence à soi. »
Notre problème n’est donc pas seulement déterminé par le capitalisme, comme tendaient à le penser les marxistes orthodoxes. Car ce ne sont pas uniquement les rapports de production matériels qui induisent notre mal-être : c’est d’abord et avant tout la mentalité dominante de notre époque, qui nous voue au « toujours-plus » plutôt qu’au « toujours-mieux ». Nous privilégions le quantitatif plutôt que le qualitatif, et nous en oublions de vivre. C’est pourquoi Thierry Maulnier avait raison de dire : « Faîtes du sport, vous ne vivrez pas plus vieux, mais vous vivrez plus jeune. » Il faut rapprendre à bien vivre, au lieu d’être obsédé par l’accumulation. Pour autant, le capitalisme demeure l’une des expressions de cette mentalité quantitativiste, et c’est bien en ce sens qu’il doit être combattu. « Pascal Bruckner, dans Misère de la prospérité. La religion marchande et ses ennemis (Grasset, 2002), […] critique moins le capitalisme que l’économisme. Critiquer le capitalisme comme effet d’une mentalité plutôt que comme une cause : il n’y a rien à dire contre cela. On ne peut être anticapitaliste sans critiquer l’économisme. » Le capitalisme renforce la mentalité quantitativiste du monde moderne. En même temps qu’il constitue une expression de cette mentalité, il constitue donc aussi un facteur essentiel de son expansion. Le capitalisme crée une société où tout le monde se trouve enferré malgré lui dans des modes d’existence nihilistes, c’est-à-dire dépourvus de sens. Et le lieu principal de cette aliénation n’est autre que le travail.
L’aliénation par le travail fait l’objet de très belles analyses tout au long du livre, comme dans cette page consacrée à Robert Kurz, Ernst Lohoff et Norbert Trenkle (Manifeste contre le travail, Léo Scheer, 2002). « La thèse est simple : le travail ne s’oppose pas au capital comme le croit un marxisme primaire, mais est transformé par le capitalisme en pur facteur de production et en ressource à valoriser. L’essentiel serait donc la critique de l’aliénation par le travail. La cause est entendue et les situationnistes avaient déjà critiqué tant le travail que le fétichisme de la marchandise, critique toujours actuelle. Mais le passage d’une critique du capitalisme à la critique du travail soulève deux objections. Elle aboutit à minimiser, voire estomper l’enjeu dont le travail est l’objet quant à la valeur qui lui est affectée et à la répartition de ses fruits. En d’autres termes, elle estompe les enjeux de classe – qui sont bel et bien réels. En outre, […] à nier les que le travail soit un invariant anthropologique, à nier ses aspects positifs de constituant d’identité, à le critiquer d’une manière radicale, on se condamne à ne pas voir les excès réels de la pression du travail, l’aliénation propre non au travail mais au salariat. On se condamne aussi à ne pas réfléchir sur les conditions de travail à changer. Ces critiques du travail […] font l’impasse sur la vraie question : restaurer la joie par le travail, lui donner une dimension créatrice, lui donner une place qui soit plus équilibrée par rapport au temps hors travail […]. »
Le travail n’est pas une mauvaise chose, en lui-même : voilà une belle leçon héritée du monde ancien ! Mais, précisément parce que le travail structure et anoblit l’homme, il doit conserver sa dimension qualitative, sous peine de devenir aliénant et d’opprimer l’âme. Le travail moderne signe trop souvent la fin de toute aspiration élevée, au nom d’exigences rentabilistes abêtissantes. C’est ce que disait par exemple Henry David Thoreau, qui s’affirmait ainsi comme un critique radical, non pas du travail, mais de l’aliénation dans le travail. Comme tous les critiques du travail, c’était d’ailleurs un grand travailleur ! Il soutenait que l’argent devient de nos jours le seul moteur du travail, alors que nous devrions plutôt travailler par goût de ce que nous faisons. Pierre Le Vigan cite un texte de 1863 : « Le but recherché par un travailleur ne devrait pas être de gagner sa vie, d’avoir un bon travail, mais de bien accomplir une certaine tâche. En outre, d’un simple point de vue pécuniaire, la ville ferait des économies en payant suffisamment ses employés de façon qu’ils n’aient plus l’impression d’accomplir leur travail pour de basses considérations, c’est-à-dire simplement pour gagner leur existence, mais pour un but scientifique, voire moral. N’embauchez pas un homme qui fait un travail pour de l’argent, mais plutôt celui qui l’accomplit parce qu’il aime sa tâche. »
Cela revient à dire que le bon travail, en fait, n’est autre que le travail libre, par opposition au salariat. Le bon travail ressemble beaucoup à ce que les Romains appelaient l’otium, que l’on traduit généralement par « temps libre ». Mais il faut bien comprendre que le loisir ainsi entendu n’avait rien à voir avec l’indolence. C’était une véritable activité, dont on s’acquittait à des fins constructives. « Dans son sens premier, le loisir était un temps pour l’étude (scholè). Tandis que le temps libre, notion plus large, était l’otium, ce qui implique l’idée d’une disponibilité, d’une ouverture. Chez les Romains, […] l’otium est le temps du repos. Non un temps de la paresse, mais un temps pour réparer la fatigue. Le loisir doit être honorable, comme le dit Cicéron à Atticus. […] Pour Sénèque (Ier siècle de notre ère), le temps du loisir doit se soucier des affaires publiques. Ce n’est pas un temps pour l’individualisme et le repli sur soi. Selon Sénèque encore, l’esprit meurt de trop de repos. »
L’homme moderne manque en définitive de loisir, de liberté et d’enthousiasme dans son travail tout comme il manque de travail, de structure et d’abnégation dans ses loisirs. Le capitalisme nous aliène à travers un salariat oppressant dévolu à la seule rentabilité, tandis que le déclin de la sphère publique nous abandonne à l’individualisme durant nos périodes de temps libre. Nous perdons à la fois le sens du travail bien fait et celui de l’action communautaire spontanée. Autant dire que nous perdons en fait notre rapport au sens tout court, car plus rien ne peut avoir de sens lorsqu’à la fois le travail et le temps libre sont ainsi désincarnés. Lire le livre de Pierre Le Vigan est donc une bonne manière de passer son temps libre. C’est un antidote au spleen et au désoeuvrement, un baume apposé sur les plaies mortifères de la modernité.
Thibault Isabel
> Pierre Le Vigan, Chronique des temps modernes, La Barque d’Or, 236 p.
13:31 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe le vigan, thibault isabel, chroniques des temps modernes | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
24/09/2014
Editorial 66 : Lou Mistrau me fa cantar...
Le Président de ce qui subsiste de la République française se soucie comme d'une guigne du sort des ouvriers de Saint-Nazaire travaillant à la construction des navires "Mistral" que la France devait livrer à la Russie. Ce n'est pas que nous soyions des chantres du productivisme militariste mais dans les conditions actuelles la livraison , suspendue dorénavant, de ces bâtiments de combat assurait leur existence économique à quelques centaines de travailleurs. Mais Hollande est grand Prince, il est généreux avec la peau d'autrui, surtout lorsqu'il s'agit de prolétaires ; il peut sacrifier des milliards d'euros que la Russie ne manquerait pas de lui réclamer en cas de rupture du contrat. Le peuple français paiera (1).
Le Président, quant à lui, est comme la cigale de la fable, il préfère chanter les louanges de l'OTAN et de la démocratie proclamée urbi et orbi, il s'associe aux chœurs des pleureuses de la haute finance qui sentent bien dépourvues de profit suffisant pendant que la paupérisation empoigne les travailleurs. Il entonne un péan à la gloire d'Obama et des Etats-Unis, s'associant à leur entreprise guerrière en Irak et en Syrie, ne sachant comment leur faire plaisir et s'en faire aimer. Il souffle dans les trompettes de Jéricho qui abattront les murailles d'un Etat islamique quasi insaisissable et mouvant mais omniprésent dans les zones géopolitiques sensibles. Il se fait le relais des hosannas d'Israël lorsqu'il s'agit de massacrer le peuple palestinien. Et puis un grand vent mistralien a traversé sa boîte crânienne, là il y trouva un symbole puissamment adéquat pour signifier sa soumission à l'ordre atlantiste! Tout le profit est pour vous, nos chers maîtres! Que pourrions-nous faire de plus pour nuire à la Russie et appuyer votre offensive en Europe orientale? Nous donnons l'exemple à nos partenaires de l'UE afin que celle-ci soit votre féale ad vitam aeternam. En récompense nous espérons participer à la danse dionysiaque qui, grâce au traité transatlantique, rendra exsangues les prolétaires européens. Nous avons déjà fait beaucoup pour les réduire au silence en intensifiant leur exploitation, en les réduisant au chômage, en favorisant le patronat et ses délocalisations, en détricotant les rares "avantages sociaux"acquis, Valls est même allé passer la brosse à reluire aux représentants du capitalisme français. Arrivé à ce stade, il est difficile d'imaginer ce que le gouvernement social-démocrate est encore capable d'imaginer afin de signifier son abjection et sa soumission au monde unipolaire prôné par le capitalisme occidental. Totalement discrédité auprès du peuple français, il s'est engagé dans une course vertigineuse à la remorque de la haute finance.
Qu'en résulte-t-il sur le plan de l'analyse de l'évolution des forces politiques en présence et sur le terrain de la lutte de classe. Il a été dit que Hollande a accompli un net virage à droite et qu'il l'assume en ayant nommé Valls au poste de premier ministre. Si l'on prend un tant soit peu de recul cela ne paraît pas aussi frappant dans la mesure où il est dans la nature de la social-démocratie d'avoir toujours cautionné la politique du capital depuis... 1914! Son essence est de toujours faire le contraire de ce qu'elle a fait miroiter afin de se faire élire aux rênes de la machine d'Etat capitaliste. Par là même, elle sécrète toujours à sa marge, de la dissidence de gauche, vivier naturel des sectes plus ou moins trotskisantes. L'originalité de notre époque réside dans l'affaiblissement définitif du PC "laurentien" en France devenu une force d'appoint du conglomérat hétéroclite de gauche qui tentera sans succès de supplanter le PS. Ce n'est d'ailleurs pas sa fonction première qui est simplement de faire survivre l'illusion de la gauche et de son idéologie proprette : discourir avec radicalité sur les misères contemporaines sans outrepasser néanmoins certaines limites de la bienséance exigée par les seigneurs de notre temps et saboter pratiquement toute velléité de lutte effective de classe qui s'attaquerait frontalement au rapport social capitaliste. Un peu d'écologisme, de féminisme, d'antifascisme, d'altermondialisme, de libertarisme sociétal, de réformisme économiste, telle est sa recette. cela a suffi pour l'instant à endiguer une colère prolétarienne qui monte mais qui n'a pas encore retrouvé pleinement ses organes de lutte révolutionnaire et qui n'ose plus penser sa seule perspective historique réelle d'envoyer la machine à extorquer du profit par dessus bord.
Pour l'instant une partie significative du peuple, dégoutée par l'oligarchie politicienne, se tourne vers le FN. Il s'agit d'une adhésion au sein d'un contexte électoraliste non remis en question. cela n'a rien d'effrayant comme le clament les hérauts de la coterie "républicaine" ; à la limite si le FN l'emportait dans le cirque électoral cela pourrait mettre le bazar dans les tripatouillages des éminents politiques. Mais très rapidement le FN devrait prendre position face aux exigences et aux nécessités de l'exploitation capitalistes. Nous doutons fort que celui-ci soit armé pour y faire face et désire réellement en découdre avec la classe dominante. Cela réclame une orientation théorique et pratique très claire sur la nature de celle-ci, sur la dynamique du processus de valorisation du capital et sur son redéploiement globalisé mondialement entraînant les soubresauts géopolitiques actuels (2).
Seule l'activité de larges secteurs prolétariens en guerre contre leurs conditions sociales imposées peut accoucher de formes politiques nouvelles exprimant leurs besoins humains. Ces formes perdureront tant que l'univers marchand ne sera pas réduit à quia. C'est la lutte contre l'existence dominée par le travail salarié et non pour un réaménagement de la croissance capitaliste, un grand coup de mistral afin de nettoyer l'atmosphère pestilentielle de l'accumulation des marchandises et y substituer l'épanouissement de la communauté humaine revitalisée.
NOTES :
1) Il est bien vrai que certains ne peuvent plus payer, et même parmi ceux le pouvant encore il s'est trouvé un député PS qui avait décidé depuis trois ans de s'abstenir de payer ses impôts et de ne plus honorer ses quittances de loyer. Faisait-il partie, avant de se faire exclure du parti, de la fraction des "frondeurs", mâles défenseurs de l'illusion démocratique, ou de sa frange radicale occulte préconisant, qui sait, la thèse anarchiste de la reprise individuelle et de la désobéissance à l'Etat? Il semblerait que non, le personnage ayant argué d'une "phobie administrative" afin d'expliquer son attitude dans laquelle, pour notre part, nous ne lisons qu'une outrecuidance propre aux membres de l'oligarchie politicienne entretenue par le système. Il est probable que les prolétaires seront eux aussi, quelque jour, frappés d'une phobie particulière, la "capitalophobie".
2) A l'attention des lecteurs distraits ou épisodiques de "Rébellion", soulignons que c'est le fil conducteur de notre revue.
07:37 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer

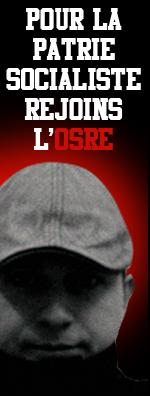
 Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net
Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

