27/02/2014
Méridien Zéro, à l'abordage des ondes !
Animée par une sympathique équipe de militants, l'émission de radio Méridien Zéro offre chaque semaine un espace de débat et d'échanges aux diverses forces dissidentes du système. Nous vous encourageons à découvrir cette radio pirate et son équipage sur le net ! Entretien réalisé dans le numéro 48 de la revue Rébellion ( juillet 2011).

R/ Comment vous est venue l'idée de lancer une émission de radio sur le net ? Quelle est l'origine de Méridien Zéro ?
C’est simple, une grande partie de notre équipe milite au Mouvement d’Action Sociale. Dans un cadre militant, nous voulions disposer d’un vecteur de communication efficace. L’idée de la radio nous est venu très rapidement. Mais il nous manquait les compétences techniques.
Nous nous sommes alors tournés vers nos camarades italiens de Radio Bandiera Nera, la web radio du mouvement Casapound Italia. Leur web radio, lancée voilà quelques années, connait un succès important. Notre proximité militante, nos amitiés nous ont aidés à comprendre les problématiques radio.
Mais le déclencheur a été notre rencontre avec Sébastien, fondateur de la communauté Zentropa, animateur du blog du même nom et l’un des animateurs de l’émission francophone du Canada «Tuons le clair de lune». Pour diverses raisons, son équipe ne pouvait plus poursuivre l’aventure et il nous a proposé de reprendre le créneau. Grace à lui et ses contacts en Italie nous avons pu lancer la radio. Nous le saluons ici et le remercions encore une fois.
Le reste, c’est de l’huile de coude, du temps et nos maigres économies …
Il faut encore remercier nos tous premiers invités et chroniqueurs. Je pense ici à PGL, Georges Feltin-Tracol, Monsieur K qui ont tous immédiatement répondu présents et ont contribué à donner le ton actuel de MZ. Il y a enfin notre camarade Sergueï le magitechnicien sans qui rien ne serait possible.
R/ Joyeusement rebelle, résolument non conformiste et ouverte à de nombreuses influences, votre équipe semble à l'écoute de toutes les initiatives issues de la dissidence au système. Comment définissez-vous l'esprit de MZ ?
Nous sommes guidés par deux sentiments : la joie et la liberté. La joie est nécessaire à ce travail militant. Il faut y trouver une motivation importante, sans cela on se lasse vite. Notre joie réside dans
La liberté ensuite, parce que nous nous sommes extirpés des contingences grincheuses du « milieu » militant. Les chapelles, courants et coteries ne nous intéressent pas. Nous servons l’idée de Révolution en aimant notre peuple et notre patrie. Mieux vaut incarner cette idée que de chercher le énième groupuscule à la mode.
R/ Plusieurs d'entre vous participent à une organisation politique, le Mouvement d'Action Sociale. Pouvez-vous nous présenter sa démarche ?
MZ/ Le MAS est plus qu’un mouvement. Nous le voyons comme l’épicentre de nombreuses initiatives de rupture et de reconquête. Notre volonté est d’agir concrètement sur des terrains trop longtemps délaissés : le social, la solidarité, l’écologie, l’anticapitalisme, le sport, la culture … Tout cela dans une visée ouverte sur le monde. Militer entre soi c’est le gage du bonheur, nous nous voulons forger un destin.
R/ Il y a une tendance forte dans la mouvance NR actuelle à prôner une «rupture militante». Quelle forme doit prendre cette volonté, pour vous ?
MZ/ La rupture doit s’entendre avant tout comme un dépassement individuel et collectif des archétypes qui nous ont jusque-là guidés. Cela ne signifie pas le reniement mais bien un bond en avant qui laisse ce qui est mort, inadéquat, dépassé et caricatural derrière nous. C’est un processus lent et difficile qui demande une attention permanente tant les vieux réflexes sont durs à extraire. Vivre la rupture c’est vouloir résolument entreprendre plus que défendre, conquérir plutôt que se replier, inventer plutôt que reproduire. La rupture est enfin le point de départ d’une reconnexion avec le réel, notre peuple et ses problématiques profondes. La rupture est le choix d’une radicalité dynamique contre celui d’une nostalgie incapacitante.
R/ MZ est au centre d'une multitude d'initiatives associatives et culturelles. Pouvez-vous nous en présenter quelques unes et en particulier votre action en faveur des sans-abris parisiens ?
MZ/ Méridien Zéro est une des initiatives du MAS. Une de nos associations, Solidarité Populaire, œuvre à aider les sans-abris de la capitale. Nous organisons avec nos bénévoles des maraudes sociales nocturnes régulières. Nous tournons en véhicules dans Paris pour distribuer nourriture, boissons chaudes et vêtements à nos compatriotes dans la misère. Nous ne sommes pas les seuls, mais la misère se combat avec l’aide de tous.
R/ Votre équipe s'intéresse beaucoup aux questions économiques et sociales, mais que pensez-vous du Socialisme Révolutionnaire Européen ?
MZ/ Nous apprécions beaucoup le travail de Rébellion. Nous sommes d’ailleurs plusieurs à lire la revue et à s’intéresser à ses travaux. Pour nous, le Socialisme Révolutionnaire Européen est l’une des façons d’exprimer notre combat. Le socialisme est la forme naturelle de la communauté organique du peuple. La révolution, loin des hystéries modernistes, doit être comprise comme le retour au centre de nos principes mais dans des formes résolument nouvelles. Pas de nostalgie, sauf celle de l’avenir. L’Europe enfin est l’espace d’expression naturel de notre esprit. C’est le socle historique, culturel, ethnique et politique de notre vision du monde.
R/ Parmi les personnes venues dans vos studios, lesquelles vous ont le plus marqués ?
MZ/ Question difficile. On peut cependant citer Gabriele Adinolfi, Laurent Ozon, Emmanuel Ratier, Tomislav Sunic, Michel Drac ou Alain de Benoist. En fait, chacun doit avoir ses préférences …
R/Il est évident pour nous que votre démarche a globalement fait évoluer les positions de la mouvance NR dans un sens positif. Quand pensez-vous ? Connaissez-vous l'impact et l'audience de votre émission ?
MZ/ Merci. Je crois que bien plus que la mouvance NR qui reste à redéfinir, nous touchons tous ceux qui se sentent à l’étroit dans les représentations actuelles du combat militant. Nous aspirons d’ailleurs à cet éclectisme. Le courrier de nos lecteurs reflète cette variété de parcours, d’âges et de conditions. Nous y voyons là un véritable encouragement. Pour ce qui est de l’audience, nous sommes en progression constante depuis un an que nous existons. Il est cependant difficile de donner des chiffres car avec les podcasts, nos émissions se démultiplient sur la toile.
R/ MZ trouve aujourd'hui une extension dans Europa Radio, Quels sont vos futurs projets ? Et vos prochaines émissions ?
MZ/ Oui, Europa Radio est une initiative de grande envergure portée par la volonté d’acier de notre ami et camarade le Baron Fou. Aidé par un de nos camarades flamand, le baron à bâti un formidable outils de combat militant et musical. Europa Radio est appelée à fortement se développer. Mais pour cela, il faut plus de volontaires, des DJ’s, des chroniqueurs. Alors n’hésitez pas à prendre contact.
Avec MZ, nous poursuivons notre voyage en éclaireurs. Nous allons essayer de traiter un peu plus régulièrement l’actualité et de nous intéresser aux problématiques scientifiques actuelles. Des quantités de choses restent à traiter !
R/ Nous profitons de cet entretien pour remercier votre équipe de votre accueil lors de l'émission de présentation de notre revue.
MZ/ Tout le plaisir a été pour nous. MZ sert et doit servir de vecteur porteur des initiatives positives de tous les patriotes conscients et radicalement engagés. Rébellion s’inscrit complètement dans une démarche de prospective, démarche qui nous l’espérons fécondera l’avenir. Merci à vous de nous avoir ouvert vos colonnes. A l’abordage et pas de quartier !

07:31 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Des communautés alternatives centenaires : Sol Veritas Lux
Les mouvances alternatives des années 1970 à 2010 n'ont rien inventé. A l'aube du 20ème siècle, la modernisation de l'Europe sous les coups de l'industrialisation et du capitalisme faisait naître des expériences culturelles et communautaires très particulières. ( article paru dans le Rébellion 42 de juin 2010 )
Des anarchistes illégalistes, buveurs d'eau et végétariens
En France, les milieux anarchistes individualistes menaient campagne pour une vie saine, avec la nécessité affirmée de suivre une éthique de vie basée sur la lutte contre l'alcoolisme (véritable fléau social qui garantit au Capital la passivité de la classe ouvrière), la promotion de l'alimentation végétarienne, le refus des règles de l'ordre bourgeois et la mise en place d'une éducation populaire émancipatrice.
A Paris, avant la Grande Guerre, des associations et des foyers anarchistes (mais aussi syndicalistes et socialistes révolutionnaires) développent de manière pratique ce mode d'existence qui se veut en dehors du système. C'est une affirmation radicale du refus de « participer » aux règles de la société qui trouve un écho particulier chez les anciens partisans de la « propagande par le fait » (c'est-à-dire les anarchistes qui utilisaient le terrorisme et la « reprise individuelle » comme moyen d'action). Militant révolutionnaire accusé par la police d'être un complice de la « bande à Bonnot », Louis Rimbault (1877-1949) fut une farouche figure de cette mouvance. Léo Malet, le meilleur auteur de polar français, connu ce genre de foyer dans les années 1930 et l'évoque dans les aventures de Nestor Burma, son personnage d' ancien anar reconverti en détective privé.
Ombres et lumières de Monte Verità
En Allemagne, le mouvement de « réforme de la vie » prônait la fuite des villes, le retour à la nature comme solution à la crise causée par le mercantilisme grandissant, le végétarisme, le refus de l'alcool et du tabac, le nudisme, les médecines naturelles (notamment les débuts de l'homéopathie), la liberté sexuelle, le mysticisme et la découvertes des spiritualités orientales.
Cas emblématique, qui à lui seul incarne les richesses et les ambiguïtés de ce genre d'expérience, la colonie de Monte Verità fut fondée par un groupe issus de la bohème bavaroise. Dans le cadre naturel magnifique du Tessin suisse, une petite communauté d'hommes et de femmes s'installe pour fonder une communauté idéale et libre. Le fils d'un industriel belge, Henri Oedenkoven finance les travaux de création d'une sorte de sanatorium végétarien. Sa femme, Ida Hofmann, professeur de piano, wagnérienne et féministe aura un rôle central dans l'expérience.
Il s'agissait de créer ce qui était voulu comme un lieu de renaissance et de régénération, de jeter les fondements d'une « nouvelle vie » hors de la structure corrompue du monde en édification. Vie communautaire, alimentation végétarienne et frugale, séances d'héliothérapie (en quelque sorte des bains de soleil, les « colons » vouaient un véritable culte à l'astre solaire) et de gymnastique : Monte Verità fut une apogée du culte du corps retrouvé. Une compagnie de danse séjourna de manière régulière dans les installations de la communauté.
Très vite, Monte Verità fut un point de rencontre pour des naturistes, des réformateurs sociaux, des militants révolutionnaires (dont beaucoup feront partis des activistes des conseils ouvriers de Bavière après la défaite de 1918), des artistes, des anthroposophes et autres théosophes de toutes les nationalités. Des dissensions se produisirent assez rapidement entre le couple des fondateurs (qui voulait développer l'image de marque de la communauté et créer un centre hôtelier de remise en forme avant l'heure) et la frange la plus radicale de la communauté. Les frères Graser reprochaient les compromis passés avec le système pour faire vivre financièrement le projet. Gusto Graser mènera la fronde et se retira dans une caverne en ermite avec sa femme Jenny Hofmann (sœur d'Ida). Sous l'influence des religions et philosophies orientales, il devient un prophète ambulant d'un panthéisme pacifique. L'écrivain allemand, Hermann Hesse fut très lié à Graser et lui rend hommage dans son œuvre la plus importante, Demian.
Le choc de la Grande Guerre devait anéantir ses tentatives alternatives, mais d'autres devaient naitre sur les ruines de notre continent. L'expérience révolutionnaire et poétique de Fiume en 1917 sera une autre forme de cette recherche d'une communauté idéale. Mais cela est déjà une autre histoire.
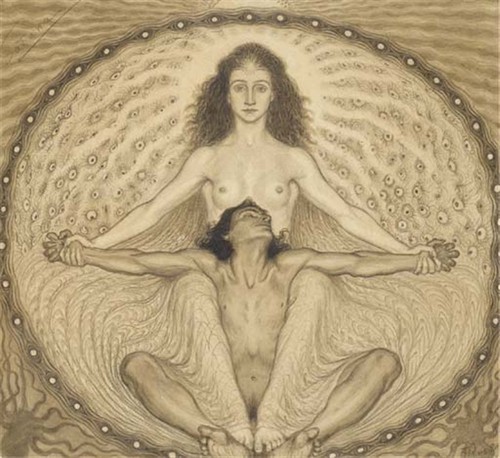
A lire sur le sujet :
Nous avons repris pour l'écriture de cet article la mine d'informations représentée par les deux numéros de la revue (DIS)CONTINUITE. Ces deux volumes contiennent plus de 400 pages chacun de textes du courant anarchiste naturien.
- Naturiens, végétariens, végétaliens et crudivégétaliens dans le mouvement anarchiste français (1895-1938), juillet 1993, 485 p. 16, 80 euros
- Communautés, naturiens, végétariens, végétaliens et crudivégétaliens dans le mouvement anarchiste français ; février 1994, 485p. 21,30 euros.
Disponible auprès de François Bochet, Moulin des Chapelles, 87800 Janailhac
Sur les divers dimensions et aspects du culte solaire, nous conseillons vivement la lecture de la revue Solaria. Publication traitant de la solarité autant du côté scientifique que spirituel, elle est une référence dans le domaine. Abonnent : 2 numéros ( un an ): 12€.
07:31 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Localisme : De la théorie à la pratique
En novembre 2011, le président du conseil italien Mario Monti déposait une requête contre la Région de Calabre devant la cours constitutionnelle du pays pour l’empêcher d’édicter des textes favorisant la commercialisation des produits agricoles régionaux (textes dits “d’encouragement à l’agriculture à kilomètre zéro“). Si la loi régionale a finalement été approuvée, les quotas garantissant 50% de produits locaux dans la restauration collective et de 30% dans les restaueants et la grande distribution ont eux été interdits, pour violation des lois européennes antiprotectionnistes.
Par ce geste, l’homme des banques et des institutions internationales montrait clairement et très symboliquement que le « localisme » était l’un de ses principaux ennemis.
La ligne de fracture est alors très claire : d’un côté les tenants du marché global et sans frontières, de l’illimité et du dérégulé, du mondialisé et de l’indifférencié, de l’autre les défenseurs de la proximité, des circuits courts, des enracinements régionaux, des spécificités territoriales et des attachements identitaires. A première vue, le combat semble largement déséquilibré. Mais la résistance localiste s’organise. Petit tour d’horizon de celle-ci.
S’inspirer du passé pour reconstruire l’avenir
Traditionnellement, les homme ont cherché à produire dans leur environnement immédiat ce dont ils avaient besoin tout en ajustant parallèlement ces besoins à ce qu’ils pouvaient effectivement produire sur un espace donné. Bien sûr, les échanges commerciaux ont toujours existé mais portaient précisément sur les denrées ou les produits que l’on ne pouvait pas produire directement autour de soi, du fait notamment du climat ou des particularismes géographiques. Ce système à la fois vivrier, polyculturel et autonome – qui a engendré les traditions culinaires et gastronomiques, les arts et artisanats locaux, et même façonné les paysages - a violemment été remis en cause par la globalisation des échanges, l’ouverture des frontières, le progrès des techniques, notamment de transports, ainsi que la financiarisation de l’économie poussant à la spécialisation territoriale.
Prenant acte des impasses environnementales, des catastrophes sanitaires, du dumping social et de la misère matérielle et culturelle engendrés par ce nouveau modèle d’économie mondialisée, les tenants du « localisme » contemporain cherchent donc à renouer avec le « bon sens » à la base des pratiques socio-économiques qui ont été la règle durant la quasi-totalité de l’existence humaine pour tous les peuples et civilisations à travers le monde. Pour autant, ils ne sont ni des nostalgiques ni de purs romantiques et ne rêvent nullement d’un utopique et illusoire « retour en arrière » mais proposent des solutions concrètes, souvent nouvelles, en tout cas adaptées au monde actuel et à ses enjeux, afin de faire face à la crise à la fois économique et civilisationnelle dans laquelle finit d’agoniser notre post-modernité. Car le localisme n’est pas qu’un concept économique, c’est également une « philosophie » écologiste et identitaire ainsi qu’ une approche des rapports sociaux qui trouve politiquement des soutiens et des promoteurs aussi bien parmi ce que l’on a coutume d’appeler « la droite » que dans les rangs de ce qu’on nomme encore « la gauche », en tout cas dans leurs franges « anti-capitatlistes » respectives.
Face au rouleau compresseur de l’idéologie libérale , la démarche localiste s’appuie sur deux axes : un travail de propositions législatives et normatives et la mise en place d’initiatives et expériences de terrain.
Une proposition phare : la détaxation de proximité
Le principe est le suivant : moduler les taxes et les charges sur les produits mis en vente en fonction de la distance parcourue par ceux-ci entre leur lieu de production et leur lieu de consommation. Cette détaxation a pour but d’encourager la relocalisation progressive des activités économiques, favorisant ainsi l’emploi local et régénérant de ce fait le lien social. Une initiative fiscale qui permettrait de donner corps au vieux slogan « Vivre et travailler au pays ! » en offrant au « local » les moyens économiques d’exister face au « global ».
Ce principe pourrait notamment s’appliquer à la TVA – par l’intermédiaire de taux différenciés selon la distance entre le lieu d’achat et le lieu de production (très réduits pour la grande proximité, réduits, normaux, majorés et jusqu’à très majorés pour des milliers de kilomètres parcours par les produits)- et à l’embauche, en modulant les charges sociales en fonction de la distance entre le lieu d’habitation et le lieu de travail de l’employé.
L’es avantages d’un tel système apparaissent nombreux :
• sociaux, par la création d’emplois répondant à l’impossibilité matérielle des Français de répondre au critère de « mobilité » exigé par les employeurs, par la recréation du lien social et par la revitalisation de territoires, notamment ruraux.
• économiques, par le primat redonné à l’économie réelle sur l’extrême financiarisation, et par la relance de l’agriculture et du tissu des PME et TPE.
• écologiques, par la réduction de la distance parcourue par les hommes et les produits et donc des émissions polluantes.
• sanitaires, par des consommations plus locales donc plus saisonnières, plus saines et également plus facilement contrôlables.
• humains, en limitant les transferts de population ainsi que les déracinements et les éclatements familiaux qui en découlent.
En France, où malheureusement la nature et le fond des idées comptent moins -surtout médiatiquement que l’image et la réputation de leur émetteur - cette proposition a souffert d’être principalement promue par le « Bloc identitaire », mouvement classé à l’extrême droite de l’échiquier politique. Elle est pourtant reprise, sous des formes diverses, à travers toute l’Europe, par plusieurs organisations d’obédiences idéologiques opposées.
Des expériences associatives et commerciales de plus en plus nombreuses
Parfois anecdotiques, ou en tout cas isolées1, souvent mises en réseau, les tentatives d’expérimentations concrètes de systèmes ou de pratiques incarnant les principes localistes se sont multipliées ces dernières années, bénéficiant d’une inquiétude grandissante des populations face aux conséquences d’une mondialisation sauvage ne bénéficiant qu’à une infime minorité oligarchique et d’un souci sanitaire et écologique croissant, notamment dans le domaine de l’alimentation secoué régulièrement par des scandales causés par les errements de l’industrie agro-alimentaire.
- Les AMAP2
Une association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) est un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une ferme locale, basé sur un système de distribution de « paniers » composés de produits de la ferme, généralement essentiellement des fruits et légumes de saison. C’est un contrat « solidaire », basé sur un engagement financier des consommateurs, qui payent à l’avance la totalité de leur consommation sur une période définie assurant donc un revenu fixe au producteur. Généralement, les bénéficiaires des « paniers » se rendent une ou deux fois par an dans la ferme productrice pour y observer le travail des agriculteurs et parfois même participer ponctuellement à l’activité de l’exploitation. Concept apparu au Japon dans les années 60 avec les teikei, les AMAP se sont développés en France à partir du début des années 2000. Au début des années 2010, on comptabilisait environ 1200 Amap sur le sol national, alimentant près de 200 000 consommateurs.
- Le Slow Food3
Le Slow Food est un mouvement fondé en Italie en 1986 par Carlo Petrini en réaction à l’émergence des « Fast food » en provenance des Etats-Unis. Opposé à l’uniformisation des goûts et des modes de consommation alimentaire, le mouvement tente de préserver les spécificités de la cuisine locale, régionale, ainsi que les plantes, semences, animaux domestiques et techniques agricoles qui lui sont associés. Il s’est rapidement étendu au-delà des frontières italiennes et l’on trouve désormais des organismes se réclamant de ce principe dans la plupart des pays occidentaux et dans certains pays d’Asie.
- Les locavores
Les locavores sont un mouvement apparu à San Francisco en 2005 (le terme est inventée par Jessica Prentice à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement) et basé sur l’idée suivante : ne consommer que des aliments produits dans un rayon de 100 miles, soit environ 160 kilomètres, autour de son lieu de vie. Après avoir connu un véritable succès populaire aux Etats-Unis et au Canada, le mouvement s’est étendu en Europe où il rencontrera un écho plus limité mais non négligeable, notamment en s’associant au développement des Amap.
- Les SEL4
Un SEL (Système d’Echange Local) est un système d’échange alternatif, basé sur le don/contre-don. Les SEL permettent à leurs membres de procéder à des échanges de biens, de services et de savoirs sans avoir recours à une transaction monétaire. Surveillées de près par l’administration fiscale qui voit ces pratiques alternatives d’un très mauvais œil, les transactions réalisées dans le cadre du SEL ne sont exonérées de TVA et d’impôts que dans la mesure où il s’agit d’une activité non répétitive et ponctuelle, type « coup de main » et n’entrant pas dans le cadre d’une profession.
Le premier SEL est apparu en France en 1994, en Ariège. A la fin des années 90, on comptait déjà plus de 300 SEL constitués de deux à plusieurs centaines de membres.
- Les monnaies locales
Plus de 2 500 systèmes de monnaie locale sont utilisés à travers le monde. En France, de nombreuses initiatives ont été lancées depuis 2010, comme Galléco en Ille et Vilaine ou l’Eusko au pays basque, avec toujours pour objectif une couverture départementale de biens et services accessibles avec cette monnaie.
Ces monnaies se veulent « solidaires et communautaires », elles ont pour but de donner de l’élan à l’économie territoriale, la population étant encouragée à consommer et utiliser des biens et services produits dans la région par les entreprises régionales et les professionnels locaux. Elles son détachées de toute logique spéculative.
- Les « Castors »5
Les Castors est un mouvement d’autoconstruction coopérative né à la fin de la Seconde guerre mondiale. On voit alors des familles se regrouper dans différentes villes de France (notamment Lyon et Villeurbanne) autour d’expériences d’auto-construction coopérative fondées sur le principe de l’apport-travail : le travail collectif, effectué pendant les heures de loisirs, vient pallier l’incapacité des personnes ainsi associées à financer l’achat ou la construction d’un logement. Le mouvement est aujourd’hui implanté au niveau national et compte près de 50 000 adhérents. S’il ne s’agit plus aujourd’hui véritablement de construire en commun, l’association garde pour but de rapprocher les adhérents « chevronnés » et les nouveaux venus afin que ceux-ci échangent expériences, conseils, « coups de mains » et « bons plans ».
- Le microcrédit
L’activité de microcrédit ou microfinance favorise et encourage les petits projets au niveau local, permettant de développer un « maillage économique » sur l’ensemble du territoire. Cet effet de levier permet d’agir efficacement auprès de ceux qui prennent des initiatives économiques personnelles, tels les entrepreneurs ou les artisans. Réalisé par des organismes caritatifs ou des structures associatives, le microcrédit permet de contourner les banques ou les établissements de crédits « classiques » et leurs taux de prêts quasi-usuraires. Initialement tourné essentiellement vers les pays dits « en voie de développement », le microcrédit s’est avéré avoir également toute sa pertinence dans les pays « développés ». L’engouement pour ce type de financement a toutefois entraîné un certain nombre d’abus, notamment la multiplication d’établissements spécialisés pratiquant des taux de recouvrement excessivement élevés.
- Les supermarchés paysans
Afin d’échapper aux intermédiaires et de ne plus dépendre des centrales d’achats des grand groupes de distribution qui souvent les étranglent, des agriculteurs ont décidé de se réunir pour investir dans l’achat ou la location d’un local, où ils se relaient pour vendre leurs produits directement au consommateur. Les producteurs associés peuvent être rejoints par des « dépôts-vendeurs » (des agriculteurs qui fournissent le magasin mais qui ne tiennent pas de permanence) ce qui permet d’accroître la gamme des produits proposés. Fondés sur le lien direct avec un producteur local ou avec un seul intermédiaire, ces modes de commercialisation ont actuellement le vent en poupe. Ils complètent et prolongent la vente à la ferme ou sur les marchés, formes traditionnelles de circuit de proximité. Des systèmes de ventes directe via internet6 voient également le jour et parachèvent une offre désormais assez large permettant de court-circuiter la grande distribution et sa logique purement mercantile et comptable.
Si les solutions localistes semblent, depuis quelques années, sensiblement gagner en légitimité et en crédibilité aux yeux de la population française et européenne, elles ne représentent néanmoins encore que des alternatives limitées, ponctuelles et parcellaires, à la toute puissance du marché global. Pour changer de dimension et incarner une véritable possibilité de « sortie » du modèle libéral mondialisé, il paraît indispensable que le mouvement localiste dépasse ses derniers blocages idéologiques et se débarrasse notamment de certaines scories gauchistes, afin d’être porteur d’un discours politique véritablement cohérent et efficient, prenant en compte toutes les dimensions de la problématique du local face au global. En effet, tant que la plupart théoriciens du localisme continueront à professer un immigrationnisme totalement schizophrénique et que les tenants de la « décroissance » passeront davantage de temps à dénoncer les « localistes et écologistes non-politiquement correct », qu’il s’agisse d’Alain de Benoist ou de Laurent Ozon7, qu’à combattre les thuriféraires du marché, leurs initiatives risquent de se borner à n’être que l’expression d’une « mode », certes sympathique, mais sans véritable portée révolutionnaire.
Xavier Eman in revue Eléments, numéro 150 ( source Zentropa infos)

07:29 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
24/02/2014
Sur le Front de la Quatrième Guerre Mondiale

La dernière traduction et parution en français d'un livre de Costanzo Preve a coïncidé avec la disparition de l'auteur. Au delà de la perte d'un ami nous voilà privés de la contribution d'un philosophe pour lequel la réflexion se nourrissait d'une confrontation avec les enjeux politiques de notre temps, ce dont témoigne l'ouvrage " La Quatrième Guerre Mondiale" (1) paru en Italie en 2008, véritable essai historico-philosophique sur la trajectoire du capitalisme moderne depuis la période de la première guerre mondiale jusqu'à nos jours. En effet, l'intérêt du livre réside dans la démarche de l'auteur consistant à se demander où nous en sommes et ce que nous pouvons faire, si l'on considère notre temps comme celui où dans un monde "post-bourgeois" et "post-prolétarien", domine "le capitalisme absolu". Cette nouvelle ère s'est ouverte lors de la disparition de l'URSS en 1991 mettant fin à la troisième guerre mondiale (guerre froide), laissant place à la quatrième guerre mondiale conduite par les Etats-Unis et ses alliés contre "le terrorisme international", c'est-à-dire contre tout ce qui n'est pas eux... Constanzo Preve interprète librement le mot de Poutine selon lequel cette disparition fut "la plus grande tragédie de l'histoire du 20° siècle". Il faut caractériser chacune des grandes guerres ayant émaillé les cent dernières années de l'histoire du capitalisme. La spécificité de l'analyse du philosophe turinois repose, en grande partie, sur la lecture géopolitique qu'il fait de celle-ci. Cette lecture n'est pas un modèle parmi d'autres possibles, choisi arbitrairement afin d'attirer l'attention d'un public universitaire. En réalité, elle nous apparaît comme étant nécessaire à la compréhension du déploiement du capitalisme. La "globalisation" de celui-ci est le renforcement extensif/intensif du rapport social initialement analysé par Marx ( reproduction élargie du capital, procès croissant de valorisation). Si Lénine pouvait parler de l'impérialisme comme étant son stade suprême de développement, il pouvait légitimement, selon nous, le définir ainsi à son époque puisque les nations capitalistes dominantes en étaient arrivées dans la course au partage du marché mondial, à la situation où allait éclater l'oecumène capitaliste d'alors ; en l'occurrence, le rapport de forces géopolitique européen (dominant la géopolitique mondiale) s'instaurant au détriment des empires austro-hongrois et ottoman éliminés en tant que tels avec à la clef un nouveau partage des colonies, des débouchés commerciaux et stratégiques et un nouveau redécoupage des frontières étatiques européennes. A partir de là, les Etats-Unis prennent le devant de la scène en devenant l'acteur principal de la réorganisation géopolitique du système capitaliste. Sans entrer dans les détails de l'ouvrage riche en enseignements de cet ordre, tirons la leçon selon laquelle les Etats-Unis ont unifié le monde occidental et ses dépendances sous le modèle atlantiste (deuxième guerre mondiale avec élimination des prétentions impérialistes des puissances de l'Axe, occupation économique et stratégique de l'Europe occidentale et d'une partie de l'Asie). Il s'agit là d'un basculement dans l'équilibre des impérialismes avec l'effacement de la domination des nations impérialistes plus anciennes se mettant de gré ou de force à la remorque de l'oncle Sam. La mystification démocratique s'impose militairement et idéologiquement alors en se cristallisant autour de la question de la guerre froide (troisième guerre mondiale) bipolarisée et perdue comme on le sait par l'URSS et ses alliés. A ce moment-là, la course au triomphe des forces atlanto-sionistes s'accélère et se traduira, entre autre, par l'agression contre l'Irak et l'ex-Yougoslavie et la tentative de démantèlement de la puissance eurasienne russe fort heureusement contrariée par le sursaut de celle-ci. En conséquence, le stade suprême du capitalisme est bien l'impérialisme se réalisant géopolitiquement pour atteindre actuellement au "capitalisme absolu" (concept de Preve). Ce stade suprême ne saurait être un achèvement définitif de sa nature, dans le temps ni dans l'espace (fantasme idéologique illusoire) mais un effort d'emprise, de domination expansionniste messianique sur le monde, s'exerçant par la course à la suppression de toutes limites quelle qu'en soit leur nature (économiques, politiques, morales, sociétales etc.). C'est le cœur de la quatrième guerre mondiale.
Pour simplifier la question, il est possible d'insister sur un premier axe d'explication visible par tous mais qui néanmoins n'apparaît pas clairement dans les consciences pour ce qu'il est. C'est la domination géopolitique des Etats-Unis sur le reste du monde par des moyens militaires utilisés directement par eux ou par leurs alliés, en particulier les forces euratlantistes (la France en fait partie). Cet usage de la force entraîne le monde toujours plus près de situations conflictuelles potentiellement fort explosives et capables de dégénérer en des guerres de grande ampleur (Syrie, Iran, par exemple). Chine et Russie ne sont plus disposées à assister en spectatrices au triomphe unipolaire de l'Empire global. Cela impose aux européens de trancher au sein de l'alternative euratlantisme/eurasisme. "L'euratlantisme par lequel les Etats-Unis tiennent l'Europe dans leur orbite n'est qu'un élément d'une stratégie géopolitique globale plus vaste, complexe et articulée." (2). Partout, en effet, la superpuissance impérialiste utilise les instruments adéquats afin d'attiser le chaos dans le monde afin d'asseoir ses objectifs (3). La question pratique, pour nous, est de savoir comment nous pourrions renverser ce rapport de force sur notre continent en donnant corps à l'orientation eurasiste. Nous avons souvent insisté sur le fait qu'il est nécessaire de faire le lien entre les aventures impérialistes et les soubresauts inhérents aux contradictions du mode de production capitaliste. L'enchaînement des travailleurs aliénés, à celui-ci, relève du même processus conduisant à la lutte impérialiste pour la domination mondiale, aux positionnements géostratégiques et géoéconomiques (mise à disposition totale des ressources de la planète afin de perpétuer le capital sur un mode de reproduction toujours plus élargie).
Le second axe d'analyse réside en "son aspect idéologique et culturel" (4). Preve reprend à son compte la définition marxienne de l'idéologie comme fausse conscience/ légitimation de la réalité inversée dans son mode d'apparition avec, néanmoins, cette précision d'ordre historique selon laquelle le mensonge utilisé afin de couvrir l'entreprise de domination est devenu dans le contexte de la quatrième guerre mondiale, un mensonge manifeste sans même un quelconque effort pour le crédibiliser comme cela était encore le cas par le passé. L'agression de l'Irak, de l'ex-Yougoslavie, de la Libye etc., se justifia par des motifs véritablement incroyables qui furent données d'emblée comme relevant de vérités indiscutables (de fait militairement imparables). L'aspect culturel de la question, quant à lui, est fondamental. Le philosophe transalpin le définit d'une façon assez large comme "le fait d'imposer une unique grammaire 'standardisée' des formes de vie, qui s'accompagne d'une colonisation générale progressive, comme 'par capillarité', de la vie quotidienne." (5). Cette hégémonie culturelle propre au capitalisme absolu est représentée par une caste intellectuelle se posant, grâce au cirque médiatique, en modèle de ce qu'il est convenu de penser et de faire (6). A ce stade de la réflexion, il est nécessaire de penser adéquatement la spécificité de la quatrième guerre mondiale sachant que "le projet hégémonique du nouvel empire américain se fonde sur une homogénéisation oligarchique et plébéienne de l'humanité toute entière." (7). Au sommet, en prenant le modèle d'un cône, des oligarchies culturellement unifiées et communiant dans les valeurs libérales, exhibant spectaculairement leur turpitude ; "au milieu, une new global middle class elle-même unifiée par les styles de consommation touristique alimentaire et musicale ; et en bas une immense plèbe..." (8). Pour résister au triomphe de ce scénario post-bourgeois et post-prolétarien, l'auteur affirme avec raison qu'il faut abandonner le clivage périmé Droite/Gauche au profit du clivage euratatlantisme/eurasisme. Néanmoins, "les conditions de 'réorientation gestaltique' de masse" vers cette prise de conscience ne sont pas encore mûres.
Le problème nous est clairement posé : nous savons ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il est urgent de dénoncer. C'est déjà un grand pas que d'échapper aux mystifications. La difficulté pratique est de savoir comment donner corps et force à l'eurasisme et à la perspective multipolaire. Costanzo Preve nous invite à ne pas "chipoter", à être géopolitiquement derrière Poutine, par exemple. Nous lui accorderons volontiers cela. Pour aller plus loin, nous n'en savons pas plus que lui quant à l'issue de cette confrontation planétaire. Par contre, nous pensons qu'un des fronts - et pas le moins essentiel - de cette guerre mondiale, se situe dans la guerre sociale que les travailleurs conduisent encore trop modestement sur le front de classe. Le prolétariat traditionnel ne renaîtra, certes pas, de ses cendres mais la majorité des salariés exploités/aliénés n'a aucun avenir supportable dans le système capitaliste. Effectivement, l'oligarchie dominante sait jouer de la bassesse de certaines passions humaines afin de maintenir la plèbe à sa place. Alors, suscitons le rejet de la marchandise, de la valeur et du salariat, et la passion pour la réalisation de la communauté humaine.
Rébellion
Notes :
1) Editions Astrée 2013. 216 p. 22,50 euros.
www.editions-astree.fr
2) p. 194.
3) Nous pensons en particulier aux ingérences plus ou moins indirectes, suscitées par les Etats-Unis et leurs alliés, dans les pays qu'il s'agit de faire basculer dans l'orbite atlantiste. Au nom de la démocratie, de véritables coups d'Etat sont appuyés soit en armant directement des bandes rebelles soit en finançant et organisant des pseudo révolutions. C'est le cas depuis quelques semaines en Ukraine où l'Occident soutient les exactions commises par des factieux d'extrême droite présentées par les medias comme étant des démocrates européistes aspirant à vivre dans le giron paradisiaque de l'UE. Au mieux, le reste des manifestants est constitué de naïfs imbéciles croyant aux sornettes euratlantistes. Mais le prolétariat ukrainien ne suit pas...
4) Ibid. p. 195.
5) Ibid. p. 196.
6) Ceux que Preve appelle "les bouffons de cour de l'aristocratie impériale" et "les eunuques du Palais" ont eu récemment l'occasion de manifester leur pouvoir de nuisance mis au service de l'extrémisme sioniste à l'occasion de l'affaire Dieudonné. Tout peut être objet de dérision de nos jours, y compris dans les termes les plus obscènes dont ne se privent pas d'user les pitoyables humoristes de la scène médiatique, hormis le tabou faisant l'objet du nouveau culte planétaire, le mysterium tremendum contemporain (a). Celui qui fait figure de profanateur est alors désigné comme bouc émissaire sur lequel peut se déverser l'ire du vulgum pecus, procédé initiant une catharsis nécessaire au déchaînement de violence symbolique ou réelle afin de purger les passions humaines aliénées au règne de la marchandise, de la monnaie et du salariat. Accessoirement est renforcé mécaniquement le caractère intangible de la politique sioniste. Sur la scène contemporaine libertarienne, des mesures liberticides concernant la liberté d'expression ont été diligemment imposées par l'appareil d'Etat capitaliste. Le ridicule de telles gesticulations étatiques est néanmoins perçu de mieux en mieux par de nombreux citoyens. La quenellophobie atteignit des sommets himalayens, mettant d'ailleurs en danger la gastronomie française ; imaginons un maître queux créatif proposant à son menu de l'ananas chaud à la quenelle, son lynchage serait assuré! Le programme de rééducation des esprits et d'imposition du Novlangue imaginé par Orwell dans "1984" se réalise sous nos yeux.
a) Deux règles essentielles pour nous : premièrement une théorie scientifique doit être falsifiable, c'est-à-dire ouverte, par le langage qu'elle adopte, à la critique et à des efforts la contredisant pour la renverser (c'est le très libéral Popper qui l'écrivait). Depuis quand la validité de l'histoire en tant que science est-elle évaluée par une cohorte de politiciens incompétents en la matière? Toute l'histoire humaine a été parcourue de tragédies, la modernité capitaliste leur a apportées sa puissance et sa barbarie technique. Deuxièmement, c'est le bouleversement et la disparition du rapport social capitaliste qui rendra impossible toute légitimité à l'impérialisme sioniste (et à quelque impérialisme que ce soit) et jusqu'à son existence même.
7) Ibid. p. 203.
8) Ibid. p.204-05.
15:32 Publié dans La revue Rébellion, Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : costanzo preve, rebellion, quatrième guerre mondiale, osre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Entretien avec Alain de Benoist : « Des animaux et des hommes »
Entretien réalisé dans le numéro 47 de la revue Rébellion ( mai 2011)

R / Dans Demain la décroissance, la question était posée du rapport de l’homme à la nature et de la valeur intrinsèque de celle-ci. Dans Des animaux et des hommes, la réflexion porte plus précisément sur le rapport de l’homme à l’animal, et a fortiori sur la question de l’homme en tant qu’animal. Quel a été le point de départ de cette réflexion ?
Le sous-titre du livre est : « La place de l’homme dans la nature ». S’interroger sur l’animal revient en effet à s’interroger du même coup sur nous-mêmes. Comme l’écrivait Condillac dans son Traité des animaux (1755) : « Il serait peu curieux de savoir ce que sont les bêtes, si ce n’était pas un moyen de savoir ce que nous sommes ». Comme les animaux, nous appartenons au monde du vivant. Nous sommes donc apparentés aux bêtes, ce que l’expérience quotidienne nous confirme à chaque instant. Mais en même temps, nous avons quand même le sentiment d’une grande différence par rapport à eux (nous publions des livres sur les animaux, mais eux n’en publient pas sur nous !). L’idée qu’en étudiant les autres vivants, nous pourrons mieux cerner ce qui nous rapproche d’eux, mais aussi ce qui nous en distingue, en découle automatiquement. C’est ce qui permet de comprendre que le sujet de mon livre n’a rien d’anecdotique. Il a au contraire des prolongements qui, depuis des siècles, n’ont cessé de mobiliser la réflexion des philosophes et des théologiens, mais aussi des chercheurs, des politologues, des sociologues et des théoriciens de toutes sortes. Le rapport de l’homme à l’animal est une façon parmi d’autres de poser la question des rapports entre la nature et la culture, l’inné et l’acquis, mais également celle des rapports entre le corps et l’esprit, l’âme et le corps, entre physis et nomos, etc. Les réponses données à ces questionnements ont été extraordinairement variées. C’est ce que je rappelle dans la première partie de mon livre, où je m’efforce de retracer l’histoire de ce questionnement et de donner une description à la fois panoramique et typologique des réponses apportées.
Pour ce qui me concerne, le point de départ de ma réflexion, outre l’intérêt suivi que je porte depuis plusieurs décennies à la philosophie des sciences et à l’évolution des sciences de la vie, a été la récente publication, par mon ami Yves Christen, d’un livre tout à fait passionnant intitulé L’animal est-il une personne ? (Flammarion, Paris 2009). S’appuyant sur des travaux scientifiques réalisés depuis une quinzaine d’années, Christen, qui connaît admirablement son sujet, croit pouvoir affirmer que toutes les frontières « étanches » que l’on avait dressées dans le passé entre le monde animal et le monde humain ont été balayées par la recherche les unes après les autres. Il en conclut que la différence entre les hommes et les animaux n’est donc qu’une différence de degré, et non de nature, ce qui l’amène à dire que les bêtes sont elles aussi des personnes. Il se trouve que, quoique rejoignant Christen sur bien des points, je ne partage pas cette conclusion. J’ai donc saisi cette occasion d’expliquer comment s’articule ma propre démarche, laquelle, je le précise tout de suite, se situe largement dans la perspective ouverte par l’école de l’« anthropologie philosophique », de Max Scheler à Arnold Gehlen, tout en étant par ailleurs fortement influencée par la pensée de Heidegger.
Historiquement parlant, on peut répartir les réponses apportées à la question des rapports entre l’homme et la nature en trois grandes catégories : d’abord ceux pour qui l’homme est pleinement un être de nature qui, à cet égard, ne se distingue pas fondamentalement des animaux ; ensuite ceux pour qui il existe une nature humaine, mais différente sous certains aspects de celle des animaux, enfin ceux pour qui il n’y a tout simplement pas de nature humaine. Ces catégories ne sont pas homogènes. La plupart des généticiens et des biologistes se situent dans la première catégorie (c’est aussi le cas d’Yves Christen), mais leur interprétation de la culture n’est pas forcément la même, selon qu’ils interprètent la culture comme une simple superstructure, qu’ils estiment qu’elle relaie mécaniquement la nature ou qu’ils postulent toute une série d’interactions pour expliquer la « co-évolution » de la culture et de la nature. La deuxième catégorie rassemble des auteurs encore plus différents, depuis ceux pour qui l’homme est avant tout un « animal de culture » jusqu’à ceux selon qui « l’homme est titulaire de droits qui sont autant d’attributs de sa nature ». Il en va de même de la troisième catégorie, puisqu’on peut aussi bien y placer les philosophes marxistes que les philosophes kantiens.
Kant et ses épigones affirment que l’homme est d’autant plus humain qu’il s’arrache à son animalité, s’affranchissant ainsi de tous les liens qui le relient à la nature. L’autonomie morale et la « dignité », dans cette perspective, s’acquièrent par un « anti-naturalisme » de tous les instants. Les tenants du réductionnisme biologique assurent, à l’inverse, que l’homme ne se comprend qu’à la lumière de sa constitution biologique naturelle, ce qui les conduit souvent à professer un « anti-culturalisme » tout aussi caricatural. Je préfère pour ma part m’en tenir à un propos de Konrad Lorenz que j’ai souvent cité. Lorsque j’étais allé lui rendre visite chez lui, en Autriche, le vieux Prix Nobel m’avait dit : « Si vous dites que l’homme est un animal, vous avez raison. Mais si vous dites qu’il n’est qu’un animal, vous avez tort ». Jusqu’à quel point l’homme est-il un animal comme les autres ? Qu’est qui lui appartient en propre, justifiant qu’on lui attribue, sinon un statut d’« exception », du moins des caractéristiques propres qui sont en rupture, non certes ontologiques, mais ontiques, avec le reste des vivants ? La notion d’émergence est-elle de nature à expliquer, sans recours à des « explications » métaphysiques dont la valeur épistémologique est nulle, l’apparition au cours de l’évolution de cette particularité humaine ? C’est là le sujet de la seconde partie de mon livre.
R/ Décréter l’égalité entre homme et animal, n’est-ce pas générer une équivalence qui risque de dégénérer en une hiérarchisation subjective ?
Le fait est qu’attribuer à tous les vivants la qualité de « personne », même si l’on s’abstient d’affirmer que toutes ces personnes sont égales, amène presque automatiquement à légitimer une hiérarchisation que l’on n’avait pas forcément l’intention de faire apparaître au départ. Même en insistant avec force sur tout ce que les animaux ont en commun avec nous (ils ont des désirs et des émotions, ils ressentent le plaisir et la douleur, ils ont une indéniable sensibilité, ils sont capables de formuler des projets, ils disposent d’un langage pour communiquer entre eux, ils ont une certaine conscience d’eux-mêmes, etc.), il est en effet difficile de leur attribuer des capacités véritablement égales aux nôtres pour ce qui est du langage symbolique, de l’appétence à l’historicité, de la conceptualisation, etc. Comment éviter, dans ces conditions, en les plaçant par rapport à nous dans un procès de continuité intégrale, de les affecter d’un moindre être ? Yves Christen, dans son livre, accorde une grande importance à la notion d’altérité, ce en quoi il a parfaitement raison. Mais le risque n’est-il pas grand de réduire cette altérité dès lors que l’on supprime toute frontière entre l’homme et les animaux ? Si tous les vivants sont des « personnes » au même titre que les humains, il y a toutes chances que les « personnes non humaines » soient regardées comme des personnes inférieures, des « hommes imparfaits » en quelque sorte, au lieu d’être considérées comme les animaux parfaitement « réussis » qu’elles sont en réalité. Il me semble que leur altérité sera mieux reconnue, et pourra être mieux respectée, si l’on admet que chaque espèce a son monde propre, son Umwelt, tandis que l’homme est le seul être « créateur de monde », dans la mesure précisément où il n’est pas définitivement rivé à un quelconque Umwelt du fait de son « ouverture au monde » et de la relative déprogrammation de l’objet de ses instincts.
R/ La rupture métaphysique entre l’homme et l’animal, comme entre l’homme et la nature, est-elle une conséquence de la vision chrétienne et de l’idéologie du progrès ? Quelle autre Weltanschauung (« vision du monde ») le paganisme propose-t-il ?
La rupture à laquelle vous faites allusion surgit inévitablement lorsqu’on se situe dans une perspective dualiste. L’opposition entre l’être créé et l’être incréé, entre le monde et Dieu, qui est l’une des caractéristiques majeures du monothéisme biblique tend alors à se prolonger par toute une série de coupures ou d’oppositions qui la prolongent : entre le corps et l’âme, l’homme et le reste de la nature, etc. Ces oppositions ne sont pas perçues comme relevant d’une quelconque complémentarité des contraires (comme pour le yin et le yang des Chinois, ou la dialectique des contraires chez Héraclite), mais comme des oppositions radicales entre des concepts qui s’excluent mutuellement selon le modèle du « jeu à somme nulle » (tout ce qui est concédé à l’un est réputé perdu par l’autre).
Dans l’Antiquité, chez les Grecs et les Romains notamment, c’est au contraire la non-dualité qui règne – ce qui ne veut évidemment pas dire l’indistinction. Aristote perçoit très bien la différence entre les animaux et les hommes, mais il ne dresse pas entre eux de frontière infranchissable, car il les situe les uns comme les autres dans un même rapport de co-appartenance à un cosmos jugé lui-même comme modèle d’harmonie. Il professe par ailleurs une théorie de la continuité des âmes, que rejettera avec force Thomas d’Aquin. L’âme, il est vrai, n’est alors pas conçue ou définie comme dans la théologie chrétienne. Pour les Anciens, l’âme est avant tout le principe de vie, le souffle vital. Il est donc tout naturel que tous les vivants aient une âme, ce qui les distingue des objets inanimés. Lorsque nous parlons aujourd’hui des « animaux », nous oublions d’ailleurs le plus souvent que leur nom provient du nom latin de l’âme, anima ! Etymologiquement parlant, et alors même que l’on prétend qu’ils n’en ont pas, les animaux sont des « êtres pourvus d’une âme »… C’est d’ailleurs ce qui permettait aux fidèles de l’orphisme, appartenant à l’école de Pythagore, d’affirmer la réalité de la métempsycose, c’est-à-dire d’une possible transmigration des âmes (d’hommes ou d’animaux). Cependant, déjà dans le stoïcisme, on insiste sur le rôle de la raison chez l’homme, en dévalorisant les animaux. Parallèlement, on voit se dessiner chez les stoïciens l’idée d’un rapport purement instrumental à la nature. Mais c’est évidemment avec le christianisme que la rupture est véritablement consommée. Non seulement les chrétiens condamnent le « culte de la nature » comme idolâtre, ce que faisait déjà le judaïsme avant eux, mais ils s’emploient à vider le cosmos de toute sacralité intrinsèque, entamant ainsi un processus de « désenchantement du monde » que la modernité conduira à son terme. Dans le même temps, ils introduisent entre l’homme et l’animal une césure radicale, de nature métaphysique, en affirmant que seuls les hommes ont une âme immortelle. C’est à partir de là que l’homme va progressivement s’excepter du discours sur les animaux, se faisant gloire de ne pas relever d’une « animalité » bientôt dégradée au rang de simple bestialité.
Bien entendu, cette conception nouvelle ne va s’imposer que progressivement, et souvent par des moyens détournés. Dans les traditions populaires, les contes et les légendes, on voit souvent des animaux parler, manifestant ainsi leur amicale proximité par rapport aux humains. Pensons également à l’importance du bestiaire médiéval au fronton des églises romanes. Et n’oublions pas non plus les élans de fraternité mystique d’un François d’Assise envers les animaux, élans qui s’étendent même à la Lune et au Soleil. Mais au-delà des oscillations dogmatiques des autorités ecclésiastiques (cf. à ce sujet le livre d’Eric Baratay, L’Eglise et l’animal, Cerf, Paris 1996), la rupture était quand même bien là. Un autre tournant très important est pris avec Descartes, dont la théorie du sujet (cogito ergo sum) implique un moi radicalement séparé du monde. Dans la philosophie cartésienne, l’homme est cet être qui se découvre lui-même, immédiatement, comme esprit et comme âme, et non comme corps. Seul l’homme est esprit, car il est le seul être pensant (d’où l’opposition entre la res extensa et la res cogitans). Le cosmos n’est plus qu’un objet mort, muet, que la science analytique doit chercher à comprendre en décomposant tous ses éléments. Quant aux animaux, ils ne sont que des « machines », les cris que pousse un chien battu n’exprimant plus la douleur, mais recevant une explication purement mécanique. (C’est contre cette théorie des « animaux-machines » que s’insurgeait Montaigne, grand défenseur des animaux, à l’instar d’un Plutarque ou d’un La Fontaine). Par la suite, on retrouvera dans la philosophie kantienne cette idée ques les animaux ne sont que des moyens dont l’homme peut disposer à sa guise, en maître et souverain du monde qu’il prétend être. La philosophie des Lumières, auparavant, avec Helvétius par exemple, aura donné naissance à la théorie selon laquelle l’esprit humain est à la naissance une « table rase », en sorte que tout ce qui s’y inscrit est exclusivement le fait de l’éducation et du milieu. L’idéologie du progrès, elle, accentuera la coupure nature-culture en plaçant la nature du côté d’un passé « naturel » dont l’homme est appelé à s’émanciper pour s’assurer des « lendemains qui chantent ».
R/ De la dimension morale de la nature humaine, peut-on décréter qu’elle est intrinsèquement bonne ou intrinsèquement mauvaise ?
Pour cela, il faut déjà avoir décidé que la nature humaine comporte une dimension morale, ce qui peut se soutenir de plusieurs façons, mais peut aussi être nié. Nombre de biologistes, pour qui la nature humaine ne se distingue pas essentiellement de celle des animaux, n’hésitent à placer l’origine de la morale dans des adaptations sélectives positives survenues au cours de l’évolution. C’est même là une thématique qui a fait l’objet de très nombreux travaux récents. Ces travaux ne manquent pas d’intérêt, mais trouvent leur limite dans le fait que la conception de la morale sur laquelle ils s’appuient est généralement d’inspiration utilitariste : la morale se ramène à des normes ou des règles de comportement dont l’observance se révèle utile à la survie du groupe. Dans une telle perspective, il est impossible d’expliquer en quoi l’éthique de l’honneur se distingue de la morale du péché, ou de comprendre la différence entre les éthiques téléologiques (Aristote) et les éthiques déontologiques (Kant). L’existence de ces différences est une preuve supplémentaire que la nature humaine ne saurait être rabattue sur celle des animaux.
Parmi les auteurs qui admettent une dimension morale de la nature humaine, les uns la jugent fondamentalement « mauvaise », car viciée par le péché originel par exemple (position de la théologie chrétienne), d’autres fondamentalement « bonne », ce qui pose alors le problème de savoir quelle est l’origine du mal (comment expliquer la négativité sociale si la société se compose d’individus naturellement bons ?). Dans la pensée chinoise, la première position est plutôt soutenue par Hsün Tzu, la seconde plutôt par Mencius ; en science politique, la première est celle de Hobbes, la seconde celle du comte de Shaftesbury, et dans une certaine mesure celle de Rousseau. Le choix que l’on fait dans cette alternative a une conséquence décisive sur la vie sociale : si la nature de l’homme est intrinsèquement bonne, la société doit chercher à éliminer ce qui empêche cette bonne nature de s’exprimer (mais le problème continue à se poser de savoir d’où proviennent les obstacles) ; si elle est intrinsèquement mauvaise, les pouvoirs publics ont le devoir de constamment rechercher à la brider (la société et les institutions deviennent l’antidote coercitif à la méchanceté ou à l’imperfection humaine). Les choses se compliquent encore du fait que chque auteur se fait souvent une idée différente du rapport de la nature à la culture. Hobbes et Rousseau, par exemple, reconnaissent tous deux le primat de la « nature », mais le premier se la représente comme essentiellement meurtrière, le second comme plutôt idyllique. Pour Rousseau, le contrat social doit s’accorder à la nature, tandis que pour Hobbes il a au contraire l’avantage de nous faire sortir d’un « état de nature » équivalant à la guerre de tous contre tous.
Mon sentiment personnel est que ces querelles résultent avant tout de problèmes mal posés. L’homme n’est certainement pas naturellement bon, mais il n’est pas non plus naturellement mauvais. Il est capable du pire comme du meilleur, de comportements égoïstes et destructeurs comme de comportement altruistes axés sur la coopération et l’entraide. Il peut s’élever au-dessus de lui-même comme il peut déchoir en dessous de lui-même. C’est en cela précisément qu’il est imprévisible, voire dangereux. Etant « ouvert-au-monde », l’homme n’est pas tant un être « mauvais » qu’un être risqué.
R/ Que penser de Clément Rosset pour qui la culture est le propre de l’homme et la nature, une « profonde et indéracinable illusion » ? Que l’homme s’arrache de l’état de nature pour accéder à l’état de culture, n’est-ce pas là justement un instinct propre à l’homme ?
J’apprécie beaucoup l’œuvre de Clément Rosset, mais il est clair que l’usage qu’il fait des mots « nature » et « culture » lui est très personnel. On peut en effet très bien penser que la culture est le propre de l’homme, sans pour autant voir dans la nature une « profonde et indéracinable illusion ». Arnold Gehlen résume ma position quand il écrit que « l’homme est par nature un être de culture ». La culture, en ce sens, ne représente nullement un « arrachement » à l’état de nature, ce qui nous ferait retomber dans une conception dualiste des choses. Elle représente bien plutôt un état de nature organisé différemment. Elle prolonge la nature en la portant à un autre niveau.
Gehlen met en rapport l’émergence de la culture avec la relative déspécialisation de l’espèce humaine. C’est cette déspécialisation qui a permis à l’homme de s’adapter à tous les milieux en les transformant, alors que toutes les autres espèces animales sont par nature attachées à un milieu spécifique. « Si le cerveau de l’homme est paradoxal, écrit Gehlen, c’est que lui et les mains ont rendu superflues toutes les spécialisations des organes […] L’homme de l’ère glaciaire n’a pas développé de fourrure, mais s’est habillé avec les peaux de bête qu’il a acquises par des méthodes intelligentes, avec le cerveau et la main ». Les outils, les artefacts, sont chez l’homme autant d’organes artificiels. L’homme dans cette optique se définit comme un « être de manque » (Mängelwesen). La notion de culture reçoit alors un éclairage entièrement nouveau. La diversité des cultures est la conséquence directe de la multiplicité dex choix que l’homme est constamment obligé de faire pour s’adapter à son environnement, le modifier et le doter de sens. La culture n’est donc nullement le « contraire » de la nature, mais elle compte bien plutôt au nombre des conditions physiques d’existence de l’être humain. En cela, elle se distingue fondamentalement des traits de culture matérielle que l’on peut observer chez certains animaux. Loin d’être un luxe, loin d’être quelque chose qui s’ajouterait à la nature à la façon d’une superstructure, elle est la condition même de l’existence de l’homme en tant qu’homme. C’est pour cela qu’il existe plusieurs cultures au sein de l’espèce humaine, alors que celle-ci ne dispose qu’une seule nature (bio-anthropologique). Pour le dire autrement, il n’a pas chez l’homme d’appartenance immédiate à l’humanité, mais toujours une appartenance médiate – une appartenance par le biais d’une culture. Il résulte de cette façon de voir les choses que ramener l’homme à l’espèce biologique revient à le dépouiller de son humanité même, c’est-à-dire aussi de son historicité.
R/ S’il n’existe aucun paradigme universel permettant de hiérarchiser les cultures, le racisme n’est-il pas lui aussi une profonde et indéracinable illusion ?
Quand on parle de racisme, il faut évidemment préciser si l’on fait allusion aux comportements ou aux doctrines, car ce sont des choses différentes. En tant que comportement ou attitude, le racisme est une forme d’autres parmi d’autres de cette altérophobie qui nous pousse à nous méfier, voire à nous opposer à ceux que nous percevons à tort ou à raison comme différents de nous (la différence est prise comme l’indice d’un possible danger). Cette attitude a des racines très anciennes, qui renvoient à l’évolution des espèces. En tant que doctrine, le racisme est une théorie moderne qui s’exprime essentiellement sous deux variantes différentes : la croyance qu’il est possible de hiérarchiser les races de façon globale, et la croyance que le facteur racial est le facteur explicatif central de l’histoire. Ces deux croyances peuvent être soutenues simultanément, mais aussi séparément, car elles ne vont pas nécessairement de pair. La hiérarchisation des cultures suppose qu’il existe un critère objectif surplombant, permettant de dire que telle ou telle race est « inférieure » ou « supérieure » à une autre. C’est en effet une illusion. Un tel critère n’existe tout simplement pas. L’examen des théories raciales ou racistes montre d’ailleurs que le critère retenu renvoie presque toujours à l’appartenance particulière de celui qui les énonce. Dire que les Noirs sont inférieurs aux Blancs revient alors à dire qu’ils sont moins Blancs que les Blancs, ce qui n’est pas vraiment une révélation.
R/ Ce rapport de co-appartenance que l’écosophie propose en opposition à l’arraisonnement du monde (Gestell), est-il possible de l’établir entre l’homme et l’animal ? L’homme n’a-t-il pas, en tant qu’« être ouvert au monde », une responsabilité envers l’animal ?
Il en a une, bien entendu. Et cette responsabilité sera d’autant mieux perçue, en effet, que nous saurons substituer au rapport de maîtrise un rapport de co-appartenance. L’homme, depuis au moins Descartes, a voulu s’instituer en « maître souverain » de la nature, et donc également des animaux. Il a voulu faire du monde un objet dont il serait le sujet. Les résultats de cette mise à disposition sont bien connus : destruction des cadres de vie, épuisement des ressources naturelles, disparition de nombreuses espèces, fuite en avant dans l’illimité du « toujours plus », etc. Retrouver la disposition d’esprit des Anciens, qui était tout à fait étranger à cette conception utilitaire-instrumentale, permettrait de voir dans l’animal autre chose qu’un objet domestique ou une proie. L’animal a une valeur intrinsèque, qui ne se ramène pas à l’affection sentimentale qu’il suscite éventuellement en nous ou à l’intérêt qu’il présente pour nous. Nous ne sommes pas que des animaux, mais nous sommes aussi des animaux. Nous avons donc des devoirs envers les animaux, ce que nos contemporains oublient encore trop souvent.
Je ne suis pas, en revanche, de ceux qui parlent des « droits des animaux », à la façon d’un auteur comme Peter Singer par exemple. D’abord parce que je crois que, d’une façon plus générale, nous aurions tout intérêt à sortir de cette omniprésente rhétorique des droits qui constitue aujourd’hui l’horizon le plus général de la réflexion politique (les « droits des animaux » représenteraient une sorte d’extension des « droits de l’homme »), ensuite parce qu’il ne peut y avoir, à mon sens, de rapports de droit que là où il existe des sujets de droit fondés à faire valoir leurs droits, ce qui n’est de toute évidence pas le cas des animaux. Nos devoirs envers les animaux, en revanche, sont une impérieuse obligation. Et il n’est pas encore interdit de faire primer les devoirs sur les droits.

07:59 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain de benoist, animaux, analyse | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer


 Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net
Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

