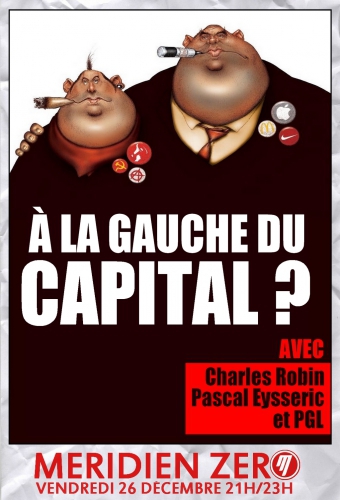28/12/2014
Tatouages, piercings et modifications corporelles : La fabrique du corps

La volonté de transformer son corps est devenue un lieu commun. Cette aspiration se retrouve de la mode des régimes au succès de la chirurgie plastique ( en attendant que la science puisse modifier dès avant notre naissance nos gènes, pour les adapter aux exigences de la mode). L'analyse sociologique que David Le Breton développe dans son livre Signes d’identité, tatouages, piercing et autres marques corporelles, évoque un des aspects les plus marquants de cette tendance.ru dans le Rébellion 42 de juin 2010 )
De la marge à la banalisation
L'histoire des modifications corporelles est aussi ancienne que les sociétés humaines. Rites initiatiques religieux ou marques tribales, elles se retrouvent dans toutes les zones géographiques. En Europe, on retrouve le tatouage aussi bien dans le monde celte que romain (déjà réservé aux militaires, puisqu'il est courant chez les légionnaires de l'Empire). Bien que stigmatisé dans les religions du Livre, il est avéré chez les premiers chrétiens comme symbole de l'attachement au Christ. Les Croisés firent de même au Moyen Age. La Révolution Française fait naitre le « tatouage politique » chez les soldats de l'An deux mais aussi chez les Chouans de l'Ouest.
Mais le tatouage fut aussi assimilé aux marques infamantes infligées aux criminels, de l'Antiquité à l'époque moderne. Le marquage au fer rouge faisant partie des outils de la justice en Europe. Il est à noter que le tatouage fut longtemps une pratique virile réservée aux marins, aux soldats et à certaines catégories de truands (les Apaches parisiens du début du XX siècle par exemple). Beaucoup de motifs apparaissent alors, mélange d'influences exotiques (les tatouages polynésiens ou japonais étant introduits en Europe par les marins du XIX siècle) ou d'inspirations propres à la vie rude de ses hommes. L'éventail de ce que nous pouvons appeler le tatouage Old Scool est déjà présent dans l'imaginaire collectif dès la fin de la Première Guerre Mondiale. Les tribus urbaines des années 1950 à 1980 (des premiers rockers et blousons noirs aux punks et skinheads) vont en faire des signes de reconnaissance et d'affiliation. Mais cela va étrangement changer dans les années 1990.
L'industrie de l'apparence
Le recours aujourd'hui courant au tatouage et au piercing est une forme significative d'un changement de relation au corps. En quelques années, ces nouveaux usages ont renversé les anciennes valeurs négatives qui leurs étaient associées. Désormais ce sont des démarches sur soi qui cristallisent une large part des engouements des jeunes générations.
Les modifications corporelles ne sont plus, comme autrefois, une manière populaire d'affirmer une singularité radicale ; elles touchent en profondeur la jeunesse dans son ensemble, toutes conditions sociales confondues, elles sollicitent autant les hommes que les femmes. Loin d'être un effet de mode, elles changent l'ambiance sociale, incarnent de nouvelles formes de séductions, elles s’érigent en phénomène culturel. Si le tatouage ou le piercing pouvaient encore être associés à une dissidence sociale jusqu'aux années 1990, ce n'est plus le cas aujourd'hui (au moins dans la majorité de ceux qui les pratiquent).
Le corps est soumis à un design parfois radical ne laissant rien en friche ( body building, régimes alimentaires, cosmétiques, prise de produits comme le DHEA, gymnastiques de toutes sortes, marques corporelles, chirurgie, body art...). Posé comme représentant de soi, il devient affirmation personnelle, mise en évidence d'une esthétique et d'une morale de la présence. Il n'est plus question de se contenter du corps que l'on a, mais d'en modifier les assises pour le compléter ou le rendre conforme à l'idée que l'on s'en fait. Les bricoleurs inventifs et inlassables de leurs corps alimentent désormais une industrie de l'apparence sans fin.
Maîtrise du corps
Les années 1980 et 1990 ont vu émerger un souci de maîtrise du corps, de gestion de son apparence, de contrôle de ses affects (un parallèle avec l'apparition du « turbo-capitalisme » néo-libéral et de la mondialisation serait à faire). L'individu est devenu le producteur de sa propre identité. Il cherche à se construire, à faire de son corps un faire-valoir, un porte-parole de l'image qu'il entend donner de lui-même. Si le tatouage des sociétés traditionnelles répète des formes ancestrales inscrites dans une filiation, les marques contemporaines, à l'inverse, ont d'abord une visée d'individualisation et d'esthétisation ; elles sont en effet parfois des formes symboliques de remise au monde, mais sous une forme strictement personnelle.
Le tatouage devient une pratique valorisante et revendiquée comme artistique. Les femmes se retrouvent de plus en plus dans cette pratique. Les modifications corporelles sont devenues d'inusables accessoires de beauté, une parure définitive qui contribue à l'affirmation du sentiment d'identité, à la mise en scène de soi.
David Le Breton, Signes d’identité, tatouages, piercing et autres marques corporelles, Editions Métailié.
17:13 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tatouages, piercings, modifications corporelles, david le breton, signes d’identité, la fabrique du corps | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
26/12/2014
Charles Robin sur MZ : A la Gauche du Capital ?
09:57 Publié dans Actualités, Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles robin, rébellion, pgl, méridien zéro | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
21/12/2014
Dialogue entre Arnaud Bordes et Jean Parvulescu : Pour une révolte littéraire au Monde Moderne
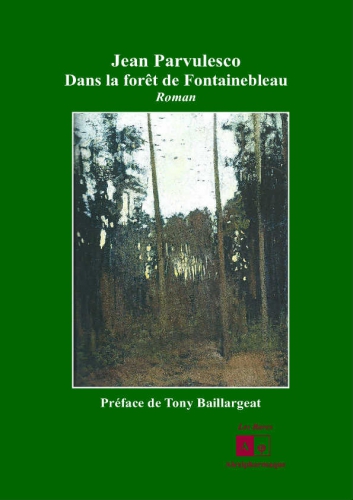
Dialogue entre Arnaud Bordes et Jean Parvulescu paru dans Rébellion
Qui êtes-vous, Arnaud Bordes ? D’où venez-vous, qu’elles sont vos origines effectives, vos antécédents ? Quelle idée vous faite-vous, secrètement, de vous-même ? Ces aveux sont-ils difficiles ?
Mes activités balancent entre l’édition – éditions Alexipharmaque ; l’écriture de recueils de nouvelles, Le Plomb (A contrario), Voir la Vierge (Auda Isarn), Le bazar de Clodagh (Auda Isarn) ; la chronique littéraire dans quelques revues ; la lecture.
Mes origines sont entre Charentes et Castille (mais seraient-elles autres, que j’en serais aussi satisfait). De moi-même, je n’ai pas d’idée, fût-elle secrète. Je me fiche assez de savoir qui je suis, laissant ces questions à l’adolescence, aux autres. J’ai des passions, que je tente de cultiver, qui m’aident : les anciens médicastres tels Ambroise Paré, Galien, les choses mornes, la littérature fantastique, la décadente aussi, et la naturaliste que je révère, les femmes au profil aquilin, les films de zombies (il n’y a pas, d’évidence, de meilleures critiques sociologiques), la musique industrielle, les « artificialistes » tels Julien Offroy de La Mettrie, Balthazar Gracián, certain ésotérisme, Fulcanelli, Dujols, Guénon, Gordon et, puisque occasion m’est donnée, et sans flatterie, votre œuvre irradiante cher Jean Parvulesco.
Comment avez-vous conçu la mise en œuvre, à Pau, des éditions Alexipharmaque ? A quelle inspiration avez-vous cédé, en l’occurrence ?
Il me semblait dommage, sinon parfaitement absurde, que des auteurs d’importance ne soient pas plus souvent, ou pas assez, ou pas du tout, édités.
Donner à de jeunes talents l’occasion d’être publiés.
Revenir, simplement mais fermement, loin des modes et des suffrages, pour d’avisés lecteurs, aux fondamentaux, aux textes : un style exigeant, un imaginaire ample, une pensée fervente, cohérente, référencée, une esthétique ; arpenter des verticalités, des hiérarchies également.
Y eut-il jamais là, comme vous le sous-entendez peut-être, quelque magique inspiration ? Le saurai-je ? A moins de considérer la proximité de Lourdes et, véritable «coincidentia oppositorum », la présence, en 1920, à Pau, qui n’est autrement que passionnante monotonie et platitude géomantique, de cet instrument de tortures, beau, coruscant et entre tous apocryphe, appelé La Vierge de fer…
Quel est le programme de vos prochaines parutions ? Est-ce un secret ?
Nombreux sont les aléas auxquels est confrontée une modeste maison telle qu’Alexipharmaque (parfaitement indépendante et sans subvention aucune). Des publications se précisent toutefois : La morale de l’histoire d’Arnaud Nîmes - roman incisif sur les liens étroits entre libre échangisme économique et transgression sexuelle, critique coupante du libéralisme libertaire. ; L’enfer de caniches de Raphaël Lambin - variation fiévreuse, noire, cruelle, gyrovague, sur le sain, célèbre, adage de Céline : « L’amour, c’est l’infini à la portée des caniches » ; assurément un autre essai du brillant cinéphile Ludovic Maubreuil…
Quelle est votre attitude à l’égard d’un éventuel projet pour la création d’une Société des Ecrivains Européens non-conformistes ?
Je suis perplexe. Je ne crois pas aux sociétés d’écrivains, je n’ai pas foi en le non-conformisme, qui ne se revendique pas, ne se partage pas (sous peine, par définition, de ne l’être plus), qui se vit intérieurement, tel un exil intérieur, si l’on veut jungerien, hielscherien. Je tiens plus pour des convergences et des solidarités tacites, d’autant plus pérennes et profondes qu’en effet tacites, des entraides souterraines et efficaces.
Croyez-vous à un prochain redressement décisif des actuelles littéraires françaises et européennes, à l’avenir, proche ou plus lointain, à la fois prévu et imprévu ? A l’avènement d’une nouvelle pensée européenne disposée à une confrontation décisive avec les tenants, visibles ou cachées, de l’œuvre négative de l’ennemi intérieur de notre civilisation, l’ennemi de l’être transcendantal de notre propre histoire et de tout ce que nous sommes ?
Au risque de vous apparaître d’un pessimisme excessif, je n’y crois pas non plus – sinon à quelques surrections ponctuelles, résurgences isolées, précisément imprévues.
En outre, dès lors qu’on y souscrit, telle est l’économie des cycles temporels : cycles qui, on le sait, sont ordre supérieur, instruisent l’Histoire, prescrivent, alternativement comme progressivement, or et harmonie, fer et chaos. Et, s’il est un ennemi, il n’est que l’expression de cette catastrophe lente qu’est notre âge de fer. Et, de même, s’il est un avènement ou un redressement, voire un retournement, il sera l’expression d’un autre âge – âge d’or, donc. Ne serait-ce pas encourir le péril de l’Inversion, que de vouloir forcer, hâter, provoquer, les desseins de Dieu, de la Providence, ou du Cosmos ? N’oublions pas : le temps ne respecte pas ce que l’on fait sans lui.
Quelles sont les orientations profondes des littératures actuelles qui vous semblent correspondre le plus avec propres vues ?
Il y a, pour n’en citer que quelques-uns uns, d’excellents auteurs : Jérôme Leroy, Pierre Bordage, Andreas Eschbach, Guy Dupré… Pour autant, je n’aperçois pas d’orientations profondes et d’ensemble dans les littératures actuelles. Et, du reste, je ne lui en demande pas tant, à la littérature. Qu’elle soit comme susdit, qu’elle soit d’abord sa propre ambition ne serait déjà pas si mal et suffirait. Ne l’accablons pas de trop de finalités. La littérature n’a jamais rien changé, à part elle-même, et, disons, quelques instants de vie.
Maisles critères de J. L. Borges, aussi, pourraient être avancés : la circularité – quand une œuvre revient se boucler sur elle-même ; la nécessité – quand une œuvre ne comporte rien d’arbitraire, d’aléatoire, de fortuit ; la totalité – quand une œuvre contient l’ensemble des possibles.
Au niveau théorique, et quelle que soit l’obédience, il y a des travaux évidemment incontournables : ceux d’Alain de Benoist, Michel Clouscard (in memoriam) Alexandre Douguine, Jean-Claude Michéa, Slavoj Žižek,Alain Soral, Jacques Ellul (in memoriam) et, pourquoi pas, si je puis me permettre, car publiés chez Alexipharmaque, ceux de Rodolphe Badinand (Requiem pour la Contre-Révolution), ceux de Louis Alexandre et Jean Galié (Rébellion, l’alternative socialiste révolutionnaire européenne).
Comment, d’après vous, pourrions-nous lutter, faire face à l’intolérable pression actuelle d’une certaine « police de la pensée », en France et dans toute l’Europe, voire dans le monde entier ? Serait-il concevable que celle-ci puisse durer, en continuité, longtemps encore ?
Simplement, avec patience et persévérance, en faisant ce que nous avons à faire. Et puisque la police de la pensée procède souvent par conspiration du silence, profitons-en, faisons-le nôtre ce silence, qui est aussi espace et étendues, en le(s) remplissant, de bruits autant que d’harmoniques.
Police de la pensée qui, paradoxalement, en nous reléguant, crée les conditions d’éprouver des valeurs qui, normalement, et d’après nombre d’auteurs de prédilection, nous importent (le devraient, du moins) : une forme d’ascèse, de discipline, d’allant vers l’essentiel, de radicalité.
En effet, comment faut-il à présent contre-attaquer, d’une manière vraiment décisive, l’entreprise de barrage permanent et de démantèlement poursuivi par l’«ennemi intérieur » et son « pouvoir rampant », pour qu’à n’en plus finir ils fassent obstacle à la présence-là de l’expression renouvelante et vive des nôtres ? Comment nous organiser offensivement, en toute lucidité, pour faire face à l’arrêt de mort que l’on nous signifie ?
Soit l’exigence et, par conséquent, un saut qualitatif dans une forme d’esseulement. Soit la facilité et la médiocrité et, par conséquent, peut-être, un saut quantitatif dans les suffrages.
On ne peut pas à la fois dénoncer l’« ennemi intérieur » (et sa manifestation systémique) et en même temps se donner d’exister en utilisant son mode pullulant d’expression.
Cesser de se poser, souvent, par rapport au « pouvoir rampant ». Mais s’imposer à nous-mêmes, être notre propre autorité.
Pourrait-on s’appuyer sur une révolte populaire ? Qui adviendra, s’il y a lieu. Ne nous leurrons toutefois pas. Il n’y aura pas de soulèvement inspiré (ou si peu) par une idéologie, une théorie, quelle qu’elle soit. Une juste exaspération prévaudra, surtout.
En outre, que nous le voulions ou pas, nous sommes tous plutôt tertiarisés, dans l’échange et l’économie de services, la maîtrise des signes, des abstractions. Et donc plutôt, fatalement, dans nos personnes mêmes, en quelque sorte, dématérialisés – quasi-apraxiques aussi. Or, quand prédominaient encore le primaire et le secondaire, que le travail était relié à la matière, à sa concrète dureté, le potentiel réactif, la capacité d’action, n’étaient-ils pas d’autant plus fermes ?
Nous ne sommes, désormais, ni dans la matière (se rappellerait-elle naturellement, régulièrement, à nous) ni dans l’esprit, le spirituel. Nous sommes dans cette zone intermédiaire, flottante, indifférenciée, tentaculaire, de leurres, qu’est le Spectacle (Spectacle dont, d’ailleurs, la prolifération est simultanée à l’émergence du tertiaire).
Et ne vous semblerait-il donc pas que, en attendant, la nécessité de la mise en place, de notre côté, d’un « dispositif de réseaux suractivés d’ensemble » devant pénétrer en profondeur le front actuel de la vie culturelle conventionnelle, totalement dévoyée par les agents de terrain et les foyers de la surveillance continuelle au service suractivé de la conspiration en place, « la conspiration du non-être » et du « politiquement correct ». Là, il s’agit, pour nous autres, d’une question de vie ou de mort.
Même réponse que précédemment.
Comment comprenez-vous le problème de l’énigmatique présence en continuité de Dominique de Roux ? Etes-vous sensible à son œuvre littéraire de rupture, à sa propre vie aventureuse et tragique ? Que pensez-vous de l’étrange - de l’inquiétante – emprise qu’il semblerait exercer à présent sur toute une frange de l’actuelle génération de jeunes écrivains qui montent en ligne ?
Je n’entends rien à Dominique de Roux, à sa littérature du moins, que je ne saurais juger mais qui, décidément, ne m’a jamais enchanté.
En revanche, je veux bien comprendre que le personnage fascine, reître ardent qui tailla des brèches, donna, presque sacrificiellement, presque oblativement, de sa personne, pour que soient des éditions, des revues, pour que des noms, des écrivains, oubliés et anathématisés, resurgissent. Mais il ne suffit pas de s’en réclamer, d’en être influencé, de le citer, quand, à la fin, l’on ne fait qu’y poser, en restant concentré sur sa plume, son ego, son petit dandysme droitard. Pourquoi ces jeunes gens ne créent pas, par exemple, de maison d’éditions, des revues, ou ne partent pas vers des confins géopolitiques ? Pour, précisément, incarner mieux, perpétuer, l’activisme, le combat, la guerre, portés par Dominique de Roux – sa manière d’abnégation.
Connaissez-vous l’œuvre géniale de Henri Bosco, à présent, déjà, tout à fait méconnue ? Et plus particulièrement son immense roman nuptial et cosmogonique, Un rameau dans la nuit ?Ne croyez-vous pas qu’il serait de vos devoirs d’état de reprendre la parution de ses livres, de réveiller l’attention des nôtres sur l’importance significative d’une affirmation de son œuvre ?
Si l’œuvre d’Henri Bosco ressortit certainement à l’ésotérisme, elle est d’abord tentative chaque fois renouvelée d’appréhender les mystères, ascension et descension dans leurs abîmes, supérieurs et inférieurs.
Mystères qui seraient comme autant de monstruosités en tant qu’ils échappent au langage. Les mystères, semble nous dire Henri Bosco, ne participent pas à l’humanité, à l’humain, d’où leur monstruosité. Et l’humain ne peut dire l’inhumain. Les mystères sont tels parce qu’ils sont indescriptibles, innommables. Un mystère ne correspond à rien, peut-être même pas à lui-même. Un mystère est, selon l’étymologie, plus anomal qu’anormal : il est sans loi, contraire à la loi, à la règle et, donc, contraire au langage, puisque le langage ordonne, puisque le langage légifère. Un mystère contredit ou, mieux, il est un non-dit ou mieux encore, un non radical, un non sans nom… Pour définir un mystère, il faudrait inventer une langue mystérieuse… Ce à quoi s’emploie Henri Bosco dont le langage, sous de simples dehors, est troublant et épiphanique. De là, également, une hantise, cette sensation d’une sourde monstruosité à l’affût dans les paysages, les décors de ses romans.
Romans où le mystère serait aussi avertissement, une sorte de borne se manifestant dans le labyrinthe de la nature – dans le labyrinthe du monde - pour signifier à celui qui s’est égaré qu’il est vraiment allé trop loin, et que s’il ne veut pas être, dans le sens d’une damnation, être perdu à tout jamais et, pourquoi pas, transformé en monstruosité, il doit s’employer avec diligence à revenir sur ses pas.
Plus qu’Un rameau dans la nuit, j’apprécie Le mas Théotime et Malicroix où les mystères, monstres de ténèbres et clartés, sont angoissants à souhait.
Quant à le rééditer, c’est à envisager.
Comment situez-vous les écrits philosophiques, ainsi que les doctrines géopolitiques d’avant-garde d’Alexandre Douguine ? N’est-il pas question, dit-on, que vous éditiez un grand volume d’entretiens inédits avec lui ? N’est-il pas question que vous vous rendiez vous-même à Moscou pour faire ces entretiens ?
Il est difficile d’atteindre un tel niveau de synthèse et d’inspiration. Célébrons, donc, Béhémoth tellurocratique ! Contre Léviathan thalassocratique et son dissolvant empire.
Des entretiens inédits ? Le rêve en est caressé.
Etes-vous vraiment conscient de l’importance que peut prendre une entreprise comme la votre, en plein développement, dans la marche des futurs combats pour la mise en situation de la plus Grande Europe continentale ? Et vous-même, êtes-vous un partisan de l’idée impériale de la plus Grande Europe continentale suivant l’axe géopolitique fondamental Paris-Berlin-Moscou ?
J’essaie de faire du mieux qu’il m’est possible. Si je peux permettre à la fois à de nouveaux talents de s’exprimer, à des écrivains de métier de continuer leur œuvre et à des pensées dissidentes de se recueillir dans un livre, je suis satisfait. Et puis Alexipharmaque va lentement, apprécie le temps qui passe, prends le temps de choisir et d’établir les manuscrits – toutes choses auxquelles je tiens, dans notre modernité perdue dans la vitesse et l’immédiat.
Quant à l’axe géopolitique fondamental Paris-Berlin-Moscou, c’est un beau concept, brillamment taillé et facetté, passionnant, aussi beau, aussi idéal que, par exemple, L’Etoile rouge, roman dans lequel Alexandre Bogdanov (théoricien par ailleurs du Proletkult) imagina une parfaite société socialiste et technicienne sur Mars.
22:13 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean parvulesco, arnaud bordes, parvulesco, alexipharmaque | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
« Penser le Réel pour sortir du Système »
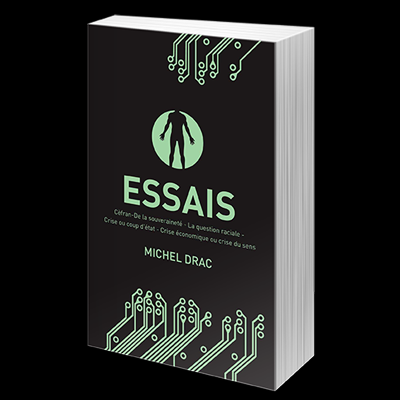
Essais de Michel Drac est un recueil d'essais écrit entre 2005 – 2009 par Michel Drac pour quatre des textes et de manière collective pour un texte, Michel Drac s'occupant de la mise en forme. Le travail d'essayiste de l'auteur consiste à offrir aux lecteurs une grille de lecture originale du présent, afin d'envisager notre futur. Chaque texte est précédé par un commentaire de l'auteur exprimant le regard qu'il porte sur le texte en 2013.
L'originalité des essais de Drac est de définir des lignes d'actions au-delà des problématiques décrites. Bien qu'il arrive évidemment de ne pas être d'accord à cent pour cent avec les possibles actions avancées par Drac, l'auteur le reconnaissant lui-même, il est tout de même très intéressant qu'elles aient été développées dans leurs grandes lignes dans les différents textes.
Bien qu'un des textes « souffre d'un déficit de méthodologie », que les propos d'un autre ait été incompris par les lecteurs, qu'un autre souffre des faiblesses de l'écriture à plusieurs mains ou que la chronologie et le tempo des événements décrits dans un autre des textes ne se soient pas réalisés exactement comme énoncés, il faut reconnaître le sérieux des essais de Drac, la pertinence des questions soulevées tout au long des textes, le courage de l'auteur pour traiter des questions aussi sensibles que le racialisme et son contraire l'antiracialisme, ainsi que le niveau élevé de réflexion de l'auteur pour traiter des questions complexes telles que le mode de pensée occidentale et le sens que ce mode de pensée produit.
Les essais « Céfran » et « De la souveraineté » traitent de deux sujets qui se recoupent à savoir celui de la francité et celui de la souveraineté du peuple français. Le premier texte commence par poser la question de la nature de la France. Selon Drac le fond du projet français consiste à mettre la force au service d'un Idéal : dans la France mérovingienne ce sont les guerriers francs qui reçoivent le baptême et font serment de servir l'idéal chrétien, dans la France des années 1790 ce sont les armées qui portent les idées de la Révolution. Après avoir décrit la nature de la France, ses identités et ses moteurs au cours des siècles, Drac s'intéresse au projet euro-mondialiste porté par les élites occidentales (France incluse), afin de comprendre quelles en sont les racines et quelles en sont les visées en termes économique, spirituel et politique. L'auteur aborde ensuite les conséquences actuelles et futures de ce projet sur la France, le « cataclysme » à venir. Enfin Drac a le courage de conclure son essai sur ce qui peut être fait pour régénérer le peuple et le projet français et être les dignes héritiers de nos ancêtres.
« De la souveraineté », texte écrit à plusieurs mains et mis en forme par Drac, aborde également le projet euro-mondialiste, mais sous un autre angle cette fois. Les auteurs partent des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises pour constater au niveau individuel ce qu'est la perte de liberté et de souveraineté lorsqu'on délègue sa sécurité à l'Etat. Ce point de départ permet aux auteurs d'aborder les sujets tels que la liberté et la souveraineté en ce qui concerne la France et évidemment le projet mondialiste libéral qui est appliqué à la France grâce au renoncement de ses élites. Dans la deuxième partie du texte, les auteurs font des propositions pour résister au mondialisme et retrouver la souveraineté au niveau de la nation française, ainsi qu'au niveau individuel et communautaire (au sens charnel). Ils se basent d'abord sur plusieurs hypothèses quant au futur de la France et partant de là, exposent le projet fractionnaire qui consiste à semer des îlots de résistance à partir desquels le peuple français pourrait se régénérer.
« La question raciale » aborde les épineuses questions du racialisme et de l'antiracialisme. Drac commence par parcourir l'histoire des racialismes modéré et extrémiste et fait de même avec l'antiracialisme. Il en déduit que le racialisme et l'antiracialisme peuvent être aussi meurtriers l'un que l'autre, l'antiracialisme n'est en rien supérieur au racialisme.
Drac entreprend ensuite une anthropologie comparée des races blanche, noire et asiatique et aborde le sujet de l'anthropogénèse au cours duquel il décrit le fonctionnement des différentes parties du cerveau (cerveau reptilien, système limbique et néocortex). Basé sur ce fonctionnement il explique en quoi la destruction de l'éducation propre aux européens (la Paideia chez les Grecs anciens) conduit à fabriquer des hommes racistes.
Drac aborde ensuite la question de l'instrumentalisation du racialisme et de l'antiracialisme en politique dans les idéologies contemporaines. La partie la plus essentielle pour nous concerne l’avènement d'un néo-racialisme biotechnologique sous couvert d'antiracialisme.
Drac conclut en mettant en garde contre le racialisme extrémiste (nazisme) et l'antiracialisme extrémiste (ce que nous vivons actuellement) et prend partie en faveur du racialisme et de l'antiracialisme modérés.
Les deux essais « Crise ou coup d'état » et « Crise économique ou crise du sens » sont également liés et traitent de la question de la crise que connaît le monde depuis 2007.
Dans le premier essai Drac parcourt un ensemble significatif de graphiques et de statistiques et les interprète. Le but de cette étude vise à montrer le rôle du système financier dans la crise actuelle, mais également à montrer en quoi l'oligarchie financière a fait de l'Asie son usine à bas coût avec des travailleurs exploités et comment elle compte calquer le niveau de vie occidental sur celui de l'Asie pour assurer sa suprématie et assurer ses profits.
Le deuxième « essai » prend plus de hauteur pour décrire la crise actuelle et surtout aborde la question de la crise économique sous l'angle de la production du sens au sein des sociétés, se basant notamment sur l'exemple de l'effondrement de l'Union Soviétique au début des années 90. Drac décrit la production de sens au sein des sociétés comme le codage et le surcodage du réel. La crise intervient lorsque le surcodage (le codage du codage) finit par être en total déconnexion avec le réel et que l'ensemble de la société en prend conscience. C'est alors qu'un nouveau sens produit par le nouveau pouvoir qui se met en place se substitue à l'ancien sens et décomplexifie le niveau de codage en supprimant purement et simplement le surcodage. Au travers d'exemples tel celui d'Enron (1) et plus généralement du surcodage à l’œuvre dans le monde économico-financier actuel, Drac montre qu'une crise du sens risque également de se produire dans les années qui viennent.
Drac conclut cet essai par décrire le type d'homme qui sera le plus à même de survivre à une crise du sens et à participer à la production du nouveau sens. Essais de Michel Drac est donc un recueil important à lire pour qui veut toucher aux problématiques que rencontre l'occident et en ce qui nous concerne, l'Europe et la France.
Florian Lejault.
Essais, Michel Drac, Editions Scribedit, 20 euros
NOTE : 1) Enron était une société américaine, dont les activités se concentraient sur le gaz naturel et le courtage en électricité. C'est cette dernière activité et le maquillage des pertes (suite à des spéculations sur le marché de l'électricité) en bénéfices qui précipita sa chute.
22:01 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel drac, rébellion, survie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/12/2014
Un émule de Maigret dans la Russie de 1917.
A propos de MADAME TCHAÏKOVSKI, publié aux Editions Astrée.
Voici un scénario inédit d’Olga Mikhaïlova, dramaturge et poétesse moscovite, et Igor Minaev, metteur en scène russe installé à paris. Ils lui ont donné la forme d’un bref roman, non sans affinités par endroits avec certaines oeuvres de Simenon – j’y reviendrai; et il est d’un grand intérêt, littéraire autant qu’historique.
C’est la frénésie hystérique de la malheureuse Antonina Ivanovna Milioukova, la femme sacrifiée à la propre folie de Tchaïkovski, et recluse à l’asile d’aliénés de Saint-Pétersbourg, qui rend naturels les retours en arrière par lesquels se révèlent, et la perversion tourmentée de l’illustre Musicien, et la vie étonnante d’Antonina jusqu’à son internement.
La personnalité de Tchaïkovski est un exemple paroxystique de ce type d’homme russe « découvert et génialement dessiné par Pouchkine », selon Dostoïevski: «… cet infortuné, vagabond sans foyer dans son pays natal, ce type historique du russe souffrant, que l’histoire devait si nécessairement faire apparaître dans notre société coupée du peuple ». (Discours sur Pouchkine, 1880). Si d’ailleurs on connaît un peu l’évolution de la musique russe au XIXe siècle, on peut trouver significatif que le seul auteur qu’ait signalé Dostoïevski, et avec éloge, dans son Journal d’un écrivain, fût Mikhaïl Glinka, le maître du fameux Groupe des cinq, dont Tchaïkovski se distingue nettement, par un romantisme beaucoup plus occidental. Quant au sort d’Antonina, bonne pianiste qui avait été élève de Tchaïkovski, elle représente une « version » russe du semblable destin de femmes européennes liées au « meilleur monde » des arts et des lettres, et femmes de lettres ou artistes elles-mêmes, comme Adèle Hugo et Camille Claudel. Camille garda ses facultés, mais ne se remit jamais de l’infidélité de Rodin, qui refusa de l’épouser, et elle s’abandonna à une vie pauvre et solitaire, que son frère Paul, ce diplomate dévot à qui les tombeaux des Ming avaient fait horreur (« C’est ici la tombe de l’Athée ! » etc.), ce moine manqué qui prétendait écrire en versets, jugea scandaleuse.
L’infortune d’Antonina résume assez bien les paradoxes de la Russie du règne des derniers Romanov; la nature de sa folie n’est autre que l’évolution maniaque d’une fidélité mystique à un amour désespéré fondé sur l’admiration, et sa fureur même le dévoiement d’une loyauté et d’une force inflexibles, dont trois des plus belles figures dans la littérature russe sont la Tatiana d’Eugène Onéguine, l’Olga d’Oblomov de Gontcharov, et la Grouchengka des Frères Karamazov. Ce monde russe en effet n’est pas le monde bourgeois européen; il est en apparence plus dur, mais il recèle des vertus, des sentiments et des clartés qui se desséchaient, s’étiolaient, s’éteignaient en Occident.
Ni Adèle Hugo après la mort de son père, ni Camille Claudel, n’ont rencontré la moindre compassion dans leur propre famille ni leur entourage, ni ceux de l’homme qui les avait tant déçues. Adèle est morte à l’Hôpital de Suresnes, après quarante ans d’internement, « engloutie », comme l’a dit Henri Guillemin, en pleine guerre de 1914. Paul Claudel, devenu oblat laïc bénédictin, a laissé sa sœur Camille mourir de faim à l’asile de Ville- Evrard, pendant l’autre guerre, où plus de quarante mille fous périrent d’inanition. C’est lui qui l’y avait fait très brutalement interner en 1915, pour « mauvaises mœurs », peu après avoir écrit « L’Annonce faite à Marie ». On peut mettre ces deux femmes au nombre de ceux qu’Artaud, à propos de Van Gogh, a appelés les « suicidés de la société ». Mais Antonina a vécu en rebelle et en amoureuse désespérée, et dans la plus entière liberté, entre 1877, l’année même de son mariage avec Tchaïkovski (qui la rejeta deux mois après, toujours vierge), et 1893, où il mourut, Quand il eut demandé le divorce, provoquant chez elle une première crise d’hystérie, la propre sœur de Tchaïkovski, Alexandra, pourtant convaincue que « son frère est un génie qui ne peut appartenir à personne », sut montrer à Antonina qu’elle l’aimait comme une sœur. Alexandra tombe en défaillance à cette nouvelle, qu’elle prend sur soi de lui annoncer, tout en s’efforçant de la consoler, de la persuader qu’elle trouvera aisément un homme qui la rendra heureuse. La famille d’Antonina lui trouve un avocat, qui d’ailleurs s’éprend d’elle; mais elle refuse le divorce. On sait en vérité peu de chose sur sa vie jusqu’en 1893, l’année où la mort de Tchaïkovski la fait sombrer définitivement dans la monomanie et la grande hystérie, qui nécessitent son internement, jusqu’à sa mort, en 1917, en pleine Révolution de Février. Le mystère dont la famille Tchaïkovski avait décidé d’entourer la mort suspecte du musicien, et sa vie la plus intime, en détruisant le plus possible de ses archives, laisse place à la fiction; et la fiction conçue par Olga Mikhailova et Igor Minaev est très pertinente.
Elle fait état de ce qu’on sait aujourd’hui de plus certain sur la mort de Tchaïkovski. La légende du choléra masque un suicide d’honneur, auquel ses tourments intérieurs l’aidèrent à se résigner. Pour avoir dépravé un cadet de seize ans, qui servait au palais impérial, il y fut poussé, avec l’assentiment tacite de la Cour, par la confrérie de ses anciens condisciples du Collège Impérial de Jurisprudence, selon un usage imité de l’Allemagne prussienne. Certains avaient trouvé que sa dernière symphonie, la Pathétique, achevée et jouée en public quelques jours auparavant, « sentait la mort » (et les auteurs du scénario imaginent que ces mots hantent toujours à l’asile l’esprit d’Antonina). On sait aussi que la famille Tchaïkovski, prenant à sa charge les frais de son internement, l’y avait inscrite sous son nom de jeune fille, et fait isoler dans un petit « secteur fermé », où elle bénéficiait d’une chambre particulière, et du droit de se promener dans le parc sous stricte surveillance, lorsqu’elle était calme.
Seul le psychiatre Kronfeld est un personnage entièrement fictif, mais parfaitement vraisemblable. Il est de ces esprits éclairés qui déplorent que la Russie ait été entraînée dans « cette guerre démentielle ». Sa profonde compassion pour la vieille folle rappelle tout naturellement la bienveillance que Gogol sombrant dans le délire mystique rencontra chez la plupart de ses amis et protecteurs; la bienfaisante amitié de Razoumikhine pour Raskolnikov, l’attention de ce dernier pour le misérable Marmeladov, l’amour d’Aliocha Karamazov pour la petite Lise presque hystérique, « éprise du désordre », etc. Dans Les Frères Karamazov, même la « psychologie à la vapeur » du très médiocre juge Kirilovitch n’est pas entièrement dépourvue de lumières sur le cas de Smerdiakov. Si l’on veut se donner la peine de chercher la clef de ce phénomène, je renvoie aux chapitres « La nuit, I et II » de la deuxième partie des Possédés, où s’affrontent Chatov et Stavroguine, deux hommes russes qui osent, qui savent l’un et l’autre regarder et aller jusqu’au fond, jusqu’au « bout de la nuit ». Mais c’est notre destin occidental que Céline et Bernanos, qui leur correspondent assez bien, se soient ignorés, irrémédiablement séparés;
et que Les deux étendards n’ait jamais eu, en soixante ans, plus de quelques dizaines de lecteurs à la fois, c'est-à-dire chaque année, selon les statistiques de Gallimard.
Notre psychiatre s’intéresse donc à la malheureuse Antonina, veut la comprendre, au lieu de la surveiller, et entreprend toute une enquête pour découvrir si les apparences de vérité qu’il a décelées dans son délire peuvent être confirmées. Il se fait détective, et même traiter de « policier » par les fonctionnaires de l’Asile, payés pour la maintenir au secret. C’est surtout son entrevue avec la vieille Madame Von Meck qui rappelle certaines enquêtes de Maigret. Cette riche et prude veuve avait aimé Tchaïkovski par lettres, été son mécène, sans le rencontrer jamais, et s’en détourna quand elle eut appris sa pédérastie. Voici les derniers mots de leur entretien, où le jeune psychiatre est un émule du célèbre commissaire :
« Puis-je faire quelque chose pour elle ? - demande Anna, radoucie.
- Je crains que non. Mais vous m’avez beaucoup aidé ».
Alphonse Boudard, dans sa préface à l’excellent Simenon ou la comédie humaine, du juge Didier Gallot, ne croit pas si bien dire en écrivant que certaines fictions que le créateur de Maigret qualifiait de « romans durs », comme « La neige était sale », sont dignes « de se placer près des grands romans de Dostoïevski ». Dans plusieurs entretiens radiophoniques et télévisés des années cinquante et soixante du siècle dernier, Simenon conseille aux jeunes gens qui se sentent une vocation de romancier de commencer par lire abondamment et intensément « tous les grands classiques, et tous les grands romanciers russes », et insiste sur son goût personnel pour « Gogol et Dostoïevski ». Pour s’en tenir à Maigret, le fait est que sa « méthode » toute intuitive, son approche du meurtrier, sa patience, sa fermeté inébranlable alliée à une profonde humanité, sont analogues à celles du commissaire Porphyre de Crime et châtiment.
Il se pourrait bien que, dans la France en bonne voie de décomposition des années 1930 à 1970, le commissaire Maigret, issu d’une antique lignée paysanne de la Sologne bourbonnaise, et médecin manqué non par sa faute, mais par des coups du sort, ait suggéré, aux yeux d’un peuple abandonné, la seule figure possible du « raccommodeur de destinées ». On peut aller jusqu’en 2005, en comprenant les deux incarnations télévisées successives du commissaire par Jean Richard, puis par Bruno Cremer, si différentes, mais l’une et l’autre souvent si intéressantes1.
En s’ouvrant à la littérature par une pièce de théâtre de la même Olga Mikhaïlova, et le scénario dont je viens de parler, les éditions Astrée nous donnent accès à une Russie réelle, qui peut nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, mais que l’Occident euro-atlantiste officiellement méprise, et désormais « déteste » - comme l’écrivait Pouchkine en 1831. On devine que le drame de Mikhaïlova, inspiré d’une correspondance de 1905 entre Tolstoï et Stolypine sur la brûlante question paysanne, est excellent. Malheureusement, sa traduction est au dessous du médiocre, et le livre tombe des mains. En récompense, la traduction de Madame Tchaïkovski par Anne de Pouvourville doit être excellente; son seul agrément en est une preuve: « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ».
NOTE :
1. Dans l’ensemble les scénarios de la série Cremer sont beaucoup moins fidèles aux romans et même à l’esprit de Simenon, et prennent souvent d’étranges libertés, comme dans Le fou de Bergerac (qui devient « Le fou de Sainte-Clothilde »), Les Vacances de Maigret, où les Sables d’Olonne sont transférés dans les Ardennes Belges, Maigret et le marchande de vin, etc.
Il faut rappeler la prodigieuse incarnation de Maigret par le grand Harry Baur, dès 1933, dans La tête d’un homme, de Duvivier. Hormis La nuit du carrefour de Jean Renoir avec Pierre Renoir, de l’année précédente, tous les autres interprétations françaises de Maigret, avant celle de Jean Richard, ne méritent que l’oubli.
Yves Branca
Madame Tchaïkovski , par Igor Minaev et Olga Mikhaïlova,
Editions Astrée, 2014, 143p, 16 Euros..
par la poste : Astrée Editions, 2 rue de Turenne, 75004 Paris
08:43 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : madame tchaÏkovski, dostoïevski | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer


 Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net
Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net