08/09/2014
Guy Debord : Le théâtre des opérations

La réédition dans un fort beau volume des oeuvres complètes de Guy Debord offre l'occasion de se plonger dans le travail théorique d'un des penseurs les plus marquants de son époque. A un long silence a succédé la récupération et la banalisation de ses idées. A la faveur de la mode lancée par quelques intellos parisiens, les rayonnages des librairies croulent depuis dix ans sous les livres consacrés au « situationnisme » et à son « chef de file ». Souvent plus fasciné par le dandysme du personnage et le côté bohème de cette « tribu », ils laissent de côté les aspects théoriques et subversifs de sa démarche.
Si le personnage et le penseur ont certes leurs limites, sa critique radicale des mécanismes de la société contemporaine fournit encore des enseignements pour qui prend la peine de les lire de manière critique. Laissons donc les interprétations des falsificateurs et plongeons- nous dans ses écrits pour nous faire notre propre opinion. La leçon principale étant de refuser tout changement qui ne serait que partiel, tout aménagement d'un système qu'il faut rejeter en bloc. Ainsi, on pouvait lire dans l'Internationale Situationniste cette définition de toute démarche révolutionnaire : « La compréhension de ce monde ne peut se fonder que sur la contestation. Et cette contestation n'a de vérité, et de réalisme, qu'en tant que contestation de la totalité ».
Les fossoyeurs du vieux monde
Né en décembre 1931 dans une famille bourgeoise, Guy Debord arrête ses études avec son bac en poche pour se consacrer aux errances de la vie de bohème. Dans le Paris de l’immédiat après-guerre, il navigue dans les diverses avant-gardes artistiques. Il participe à une bande informelle de révoltés en rupture de ban. Dans les arrières salles de cafés douteux et enfumés, où les vapeurs sacrées de l'alcool font des ravages dans leurs rangs, ils se lancent dans un vaste projet de dépassement de l'art. Pour le faire sortir des musées et le réaliser dans la vie quotidienne, tous les moyens son bons. De l'architecture au cinéma, ils remettent en question les fondements utilitaires de la société moderne. Le petit groupe refuse l'enrégimentais et cultive le goût du scandale. Rien n'est sacré pour eux, pas même les vieilles icônes du surréalisme qui sont la principale cible de leurs coups d'éclats. Dans cette dérive effrénée, Debord se déclare cinéaste et réalise une série de films des plus étrange, tant au point de vue de la forme qu'au niveau du message. Rallié au mouvement lettriste, sa curiosité insatiable et son intelligence sans cesse à l'affût l'amènent à être très tôt, lucide sur les limites des avant-gardes purement artistiques. « La formule pour renverser le monde, nous ne l'avons pas cherchée dans les livres, mais en errant » écrira-t-il. Fuyant, déjà, les récompenses que l'établissement réserve à ses opposants domestiqués, il veut aller plus loin.
La fondation de l'Internationale Situationniste traduit cette radicalisation. Devant réunir des artistes venus de toute l'Europe, le groupe prend très vite un tournant politique. Ne se contentant plus de la simple remise en question de l'art, ils étendent désormais leur contestation à l'ensemble de la société.
« L'IS ne peut pas être une organisation massive et ne saurait même accepter des disciples. L'IS ne peut être qu'une conspiration des Egaux, un état-major qui ne veut pas de troupes (...) Nous n'organisons que le détonateur : l'explosion libre devra nous échapper à jamais, et échapper à quelque autre contrôle que ce soit », affirmaient les situationnistes en 1963. La vie interne de cette Internationale qui ne comptera jamais plus de 70 membres (mais de seize nationalités différentes) fut des plus agitées. D'exclusion en démission, chaque rupture est « habillée » d'une savante et cruelle rhétorique pour cacher des querelles souvent personnelles. Il y a toujours deux raisons aux choses, commentera à ce propos Michèle Bernstein (membre de l'IS et compagne de Debord à l'époque). Il y a toujours la bonne raison, et il y a toujours la vraie raison ». Mais n'oublions pas qu'au delà des vicissitudes de vies hors normes, il y a chez les situationnistes un intense travail théorique.
Les sources de leur inspiration sont multiples. Sous l'influence de Hegel, de Feuerbach et de Marx, ils découvrent des auteurs marxistes non-orthodoxes comme le hongrois Lukàcs ou l'allemand Korsch. Ils n'ignorent pas l'histoire des courants libertaires ou d'ultra-gauche, en particulier les diverses expériences conseillistes. Ils puisent aussi dans les travaux contemporains de la revue Socialisme ou Barbarie ou du philosophe Henri Lefebvre. Au niveau du style, il est indéniable que la tradition littéraire française des « auteurs maudits » (Lautréamont, Rimbaud...) a donné un ton particulier à leurs écrits. Pour l'IS, la théorie n'est ni plus ni moins que ce qui vient renforcer la pratique d'un mouvement. « Nous voulons que les idées redeviennent dangereuses » affirmait Guy Debord.
Le mélange sera explosif. Leurs théories commencèrent à attirer l'attention avec la parution du brûlot De la misère en milieu étudiant. Réalisé par une bande incontrôlée d'étudiants de Strasbourg influencés par l'IS, il lance une nouvelle forme d'expression révolutionnaire. Suivront La Société du Spectacle de Guy Debord et Le Traité de Savoir vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem. Ces livrent eurent une très forte influence dans les milieux étudiants d'Europe et d'Amérique du Nord où ils furent largement diffusés et commentés par les futurs « enragés » de Mai 68. Le sens de la formule choc des situs qui maniaient savamment à la fois l'ironie et l'humour devait donner naissance à des appels insurrectionnels qui allaient fleurir bientôt sur les murs des universités de toute la France. Leur influence souterraine sur le « joli mois de Mai» s'explique par la séduction qu'opéra leur intransigeance. On retrouve les situs lors de l'occupation la Sorbonne, où ils participent activement au comité de grève étudiant et s'opposent violemment aux groupuscules trotskistes et maoïstes. Facétieux, ils en profitent pour abreuver de télégrammes d'insultes l'ambassade de Chine Populaire aux frais de l'université (non sans un certain humour : « Tremblez bureaucrates STOP Le pouvoir international des Conseils Ouvriers va bientôt vous balayer STOP L'humanité ne sera heureuse que le jour où le dernier bureaucrate aura été pendu avec les tripes du dernier capitaliste STOP ») et pour expulser Alain Krivine d'une AG. Mais plus sérieusement, ils seront de toutes les initiatives pour élargir le mouvement vers le monde ouvrier.
Après que le pouvoir eût sifflé la fin de la récréation, les situationnistes durent faire face à une médiatisation incroyable de leurs actions, cette célébrité inattendue va provoquer la naissance d'une multitude de noyaux « pro-situs » faits de bric et de broc, qui ne furent jamais reconnus par Debord. La mode est alors à la révolution et toute une génération verse dans « l'extrémisme révolutionnaire ». Certains réalisent d'ailleurs d'importants bénéfices commerciaux sur cet engouement. Voulant éviter les manipulations et la récupération, les trois derniers membres de l'IS (dont Debord, les autres ayant été exclus...) déclarent l'autodissolution de l'organisation au printemps 1972.
Débute alors pour Debord un long cheminement solidaire durant lequel il affirme une pensée en rupture avec l'époque. Refusant toute forme de médiatisation, il est vite entouré d'une sulfureuse réputation par des journalistes toujours à l'affût d'un scoop. Il est probable, que l’auteur de la Société du Spectacle s'amusera à jouer avec cette image d'homme de l'ombre.
Mais le jeu prendra fin. Miné par un cancer, il se donnera la mort en novembre 1994. Ce dernier salut à un monde qu'il avait toujours refusé prend un sens particulier quand on regarde les itinéraires parallèles d'autres acteurs de cette mouvance. A la fin des années 70, le reflux révolutionnaire va laisser toute une génération échouée. Drogue, suicide, alcoolisme ou banditisme « politisé » : certains s'enfermeront dans une course vers le vide. Peu en sortiront indemnes. Comme expliquer ce désespoir ? Voilà un aspect peu connu et passé sous silence par beaucoup d'ex-gauchistes reconvertis sans honte dans les affaires. Pour avoir vécu une époque palpitante, ces révolutionnaires perdus ont refusé de rentrer dans le moule et se sont enfoncés dans l'autodestruction la plus totale. Ne pouvant parvenir à détruire le système, ils se sont détruits eux- mêmes. A nous de ne pas refaire les mêmes erreurs...
La Société du spectacle : la vérité nous rendra libre !
Livre le plus connu de Debord, il est souvent cité sans avoir était simplement lu... Si on s'en tient aux formules chocs, la définition qu'il donne au terme de Spectacle est qu'il est « le règne autocratique de l'économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable ». Cela nous laisse sur notre faim...
Pour nous référer à l'analyse d'Anselm Jappe sur la pensée de Guy Debord, la Société du Spectacle n'est pas seulement le règne tyrannique de la télévision ou des mass média. Cela n'est que sa manifestation superficielle la plus écrasante. Le fonctionnement des moyens de communication et d'information de masse exprime parfaitement la structure de la société entière dont ils font partie. La contemplation passive d'images, qui de surcroît ont été choisies par d'autres, se substitue au vécu et à la détermination des événements par l'individu lui-même et la pratique collective. Ces phénomènes amenant un appauvrissement constant de la vie réellement vécue, sa fragmentation en sphères de plus en plus séparées, ainsi qu'à la perte de tout aspect unitaire dans la société (repaires culturels et temporels). Dans ce monde totalitaire, le Spectacle apparaît comme l'aliénation idéologique par excellence. Le Spectacle dans la société correspond à une fabrique concrète de l'aliénation.
Tandis que le pouvoir de la société dans son ensemble paraît infini, l'individu se retrouve dans l'impossibilité de gérer son propre univers. Guy Debord décelait dans cela la conséquence du fait que l'économie a soumis à ses propres lois la vie humaine. Aucun changement à l'intérieur de la sphère de l'économie ne sera suffisant tant que l'économie elle-même ne sera pas passée sous le contrôle conscient des individus. Reprenant le travail des courants minoritaires du marxisme, il assigne une importance centrale au problème de l'aliénation considérée non comme un épiphénomène du développement capitaliste, mais au contraire comme son noyau central. Le développement de l'économie devenu indépendant, est l'ennemi de la vie humaine qu'elle tente de conditionner à ses objectifs. Ainsi, l'homme se retrouve reproduit par les méthodes de production qui lui sont imposées par la recherche de la rentabilité, sans souci de sa santé et de son épanouissement humain. Il est de plus conditionné par ses « loisirs » et la consommation. A l'ouest comme à l'Est, dans les pays développés comme dans ceux du Tiers-monde, la logique de la marchandise règne sur l'ensemble du système social, où les individus ont perdu tout pouvoir et tout contrôle sur leur propre vie.
Sans rival, le Spectacle est l'auto-justification permanente du système de production dont il est issu. Pour ce faire, il n'a pas besoin d'arguments sophistiqués : il lui suffit d'être le seul à parler sans attendre la moindre réplique. Il n'est pas une simple forme de propagande, c'est l'activité sociale tout entière qui est captée par le Spectacle à ses propres fins. Toute la vie des sociétés modernes « s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans la représentation ». L'image se substitue partout à la réalité et donne naissances à des comportements réels formatés par elle. Cette structuration des images sert bien évidemment les intérêts d'une partie de la société, l'oligarchie. Avec l'époque moderne, le pouvoir a eu la possibilité de modeler la société dans le sens de son maintien. Cela passe par la falsification de la réalité à tel point que « dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux » affirmait Debord. Les normes les plus aberrantes de ce système deviennent familières à tous, elles sont acceptées et intégrées au comportement de l'ensemble de la société. Il suffit d'observer le comportement des générations nées sous sa pleine domination pour comprendre l'étendue de son emprise sur les esprits. Sous son règne, la connaissance et le sens critique ont été soigneusement éliminés pour ne laisser aucun repaire pouvant remettre en cause son existence.
Le Spectacle parvient à son apogée lorsqu'il arrive à créer l'illusion de l'unité de la société en masquant les divisions de classes. « L'unité irréelle que proclame le Spectacle est le masque de la division de classe sur laquelle repose l'unité réelle du mode de production capitaliste ». Et c'est aussi bien cette unité réelle d'une même aliénation qui se cache sous les fausses oppositions spectaculaires (« Droite/Gauche » par exemple). A l'époque de la Guerre Froide, les situationnistes affirmaient que le Spectacle servait à masquer « l'unité de la misère » en opposant deux mondes, d'une part le capitalisme occidental ( le spectaculaire diffus qui « accompagne l'abondance des marchandises, le développement non perturbé du capitalisme moderne ») et d'autre part le capitalisme bureaucratique soviétisé ( le spectaculaire concentré qui est le totalitarisme bureaucratique ), qui tous deux ne représentent en fait que la même aliénation exprimée sous des formes différentes. L'évolution du monde amènera plus tard, Guy Debord dans Les commentaires sur la Société du Spectacle paru en 1988 à constater la naissance du spectaculaire intégré qui à pour base le mensonge généralisé. Notre certitude de ne pas être trompé est désormais mise à mal par la découverte des pires manipulations étatiques. A ce stade, le Spectacle doit nier l'histoire, car celle-ci prouve que sa loi n'est rien, mais que tout est processus et lutte. Le Spectacle est le règne d'un éternel présent qui prétend être le dernier mot de l'histoire.
Mais l'histoire poursuit sa marche révolutionnaire. Les Situationnistes vont mettre au coeur de leur démarche la rupture révolutionnaire avec les faux semblants du Spectacle. Ils avaient pour but la création de situations, c'est-à-dire de moments de rupture qui permettent à la vie réelle de s'imposer à la survie au quotidien dans laquelle l'individu est enfermé. Le vécu est au coeur de la conception politique situationniste. La reconquête du quotidien passe par la prise de conscience de la nature artificielle des représentations médiatiques. Pour Raoul Vaneigem, l'homme pour se libérer de l'emprise spectaculaire doit retrouver « le goût enragé de vivre » en redevenant le seul maître de ses désirs.
Dans les conclusions de son maître livre, Debord est amené à présumer que le Spectacle se brisera contre un sujet qui dans son essence est irréductible à la spectacularisation. Un sujet devant être porteur d'exigences et de désirs différents de ceux causés par le Spectacle. Ce sujet résistant au phénomène est identifié par Debord au Prolétariat (1). Le prolétaire n'est plus seulement défini par ses conditions de travail, il est devenu « l'immense majorité des travailleurs qui ont perdu tout pouvoir sur l'emploi de leur vie et qui, dès qu'ils le savent, se redéfinissent comme prolétariat ». Partant de son expérience quotidienne de la marchandisation du monde, ce prolétariat élargi doit devenir la « classe de la conscience ». La Conscience signifie le contrôle direct des travailleurs sur tous les moments de leur vie. Grâce aux Conseils Ouvriers avec lesquels les prolétaires peuvent d'abord conduire la lutte et par la suite gouverner une future société libre. L'opposition entre la vie humaine et les forces aveugles de l'économie ne laisse aucune place au doute. La véritable ligne de fracture se situe entre ceux qui veulent ou qui doivent conserver l'aliénation spectaculaire et ceux qui veulent l'abolir. Le reste n'est que diversions...
Note
1 - Comme le fait justement remarquer Anselm Jappe, les situationnistes n'avaient pas soupçonné que le prolétariat pourrait être rongé à l'intérieur de lui-même par les forces de l'aliénation, le faisant s'identifier activement au système qui le contient. Pour Debord, toujours lucide, la question n'était pas de savoir ce que les travailleurs sont actuellement, mais ce qu'ils peuvent devenir – et ce n'est qu'ainsi que l'ont peut comprendre ce qu'ils sont déjà.
Biblographie
Guy Debord – Oeuvres Complètes – Gallimard/Collection Quarto.
Anselm Jappe – Guy Debord – Denoël/Essai.
Laurent Chollet – L'insurrection Situationniste – Dagorno.
09:43 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy debord | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
04/09/2014
Pour une Ecologie véritablement révolutionnaire :Détruire ce qui nous détruit
Le combat écologiste est-il porteur, par lui-même, d’une véritable perspective révolutionnaire ? Nous pensons que non. Aussi virulente que puisse prendre son expression, il reste englué dans sa vision limitée du problème. S’il a la capacité de deviner les futures catastrophes, il est dans l'incapacité matérielle de les contrer. L’échec de l’Ecologie politique et les demi-succès de l’Ecologie Radicale sont révélateurs de la logique d’un mouvement qui n’arrive pas à remonter aux sources du Mal et qui ne parvient qu’à être récupéré par le système ou à s’enfermer dans une surenchère stérile.
Pour reprendre l’analyse de l’équipe de l’Encyclopédie des Nuisances (1), les écologistes représentent sur le terrain de la lutte contre les nuisances écologiques ce que représentaient, sur celui des luttes ouvrières, les syndicalistes : des intermédiaires intéressés à conserver les contradictions dont ils assurent la régulation, des négociateurs voués au marchandage (la révision des normes et des taux de nocivité remplaçant les pourcentages des hausses de salaire), des défenseurs du quantitatif au moment où le calcul économique s'étend à de nouveaux domaines (l'air, l'eau, les embryons humains ou la sociabilité de synthèse); bref, les nouveaux courtiers d'un assujettissement à l'économie dont le prix doit maintenant intégrer le coût d'un "environnement de qualité".On voit déjà se mettre en place, cogérée par les experts "verts", une redistribution du territoire entre zones sacrifiées et zones protégées, c’est-à-dire une division spatiale qui réglera l'accès hiérarchisé à la « marchandise nature ». Quant à la radioactivité, il y en aura pour tout le monde.
Dire de la pratique des écologistes qu'elle est réformiste serait encore lui faire trop d'honneur, car elle s'inscrit directement et délibérément dans la logique de la domination capitaliste, qui étend sans cesse, par ses destructions mêmes, le terrain de son exercice. Dans cette production cyclique des maux et de leurs remèdes aggravants, l'écologisme n'aura été que l'armée de réserve d'une époque de bureaucratisation, ou la « rationalité » est toujours définie loin des individus concernés et de toute connaissance réaliste, avec les catastrophes renouvelées que cela implique.
Partant du constat que la société capitaliste actuelle mène par son mode de production et de consommation à la destruction inévitable de notre environnement, nous intégrons pleinement l’écologie à un combat révolutionnaire. Nous la concevons comme une composante d’un projet plus vaste de remise en cause du capitalisme et non comme la motivation unique et principale d’une démarche réformiste. La contradiction entre le milieu naturel et le système capitaliste mondial est totale. Il n'y a aucun terrain commun, rien qui puisse enjamber la séparation définitive entre la préservation de notre planète et la logique d’exploitation sans limites de ses ressources, par le Capital.
C’est sur le terrain des rapports sociaux que se remportera la victoire de la défense de la Nature parce que c’est sur ce terrain là que se concrétise la conscience des enjeux majeurs afin de rompre avec la dynamique productiviste génératrice de pollution mais aussi de chômage et de crises. Seule la Révolution Socialiste pourra mettre fin au système en place et donner naissance à une nouvelle société, qui aura comme préoccupations (entre autres) de rechercher un rapport harmonieux avec son environnement. Parce qu’il ne sera pas guidé par le profit et organisé en firmes multinationales ou étatisées bureaucratiquement, notre Socialisme pourra être et sera un mode de production écologique. Il fera peut-être des faux pas, mais il n’introduira pas de façon systématique et aveugle des déséquilibres dans les cycles naturels, comme le fait le capitalisme. Il n’est pas la correction des lois économiques suivant des critères écologiques, mais le dépassement de la loi de la valeur et de l’économie.
Ce que met en avant la crise écologique, c’est la nécessité de ce dépassement, le caractère devenu absurde socialement de la loi de la valeur qui écrasait déjà l’existence des travailleurs pour augmenter à tout prix la productivité du travail afin d’accroître le profit.
Le Socialisme sortira de la loi de la production pour la production (valorisation du capital, productif ou financier), afin d’élaborer une approche différence de l’économie qui ne soit pas nocive à terme pour notre environnement, et pour la nature, plus largement. Si nous rejetons la course aveugle à la croissance nous ne pouvons souscrire à l’illusion de la décroissance et à sa phobie de la technologie. Basée sur les réels besoins humains- que la société aura à redéfinir- et non sur les artifices de la consommation de masse, la production sera orientée impérativement pour éviter des effets irréversibles ou difficilement réversibles quant à leurs effets sur l’homme et sur la nature. Le but étant d’obtenir une prodigalité de biens d’usage peu coûteux et de qualité, sans impacts destructifs sur l’environnement. La révolution transformera profondément le sens du développement technologique et les conditions de production.
Le mal n’est pas la technique mais l’utilisation qui en est faite par le Capital ainsi que le projet techniciste contemporain de la naissance des prémisses du capitalisme aux 16° et 17°siècles. L’innovation technologique n’est pas pour le moment un moyen de développer les possibilités de l’espèce et d’alléger ses peines, mais de faire produire plus de marchandises et mieux asservir le travailleur. Cela peut très bien changer si nous émancipons la technologie de la recherche du profit. Il est évident qu’un tel changement implique une rupture radicale qui ne peut être que la Révolution Socialiste ! De nos refus naît le futur !
Note :
-
Encyclopédie des Nuisances, « A tous ceux qui ne veulent pas gérer les nuisances mais les supprimer », appel de 1991.
08:36 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ecologie, eco-socialisme, socialisme révolutionnaire | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
L’Ecologie Sociale : L’autre Ecologie Radicale

Un profond débat a agité le mouvement écologique radical américain de la fin des années 80. L’apparition de l’Ecologie Sociale, en réaction aux limites et dérives de l’Ecologie Profonde, va considérablement enrichir et rénover le discours sur l’Ecologie. Quasiment inconnu en France, son principal pionnier fut Murray Bookchin, intellectuel écolo-libertaire qui se définit comme un héritier de la longue tradition de lutte sociale américaine et en particulier des IWW (1). Il s’opposa, dés 1987, à la misanthropie latente présente dans la mouvance des écologistes radicaux sous couvert d’un culte de la nature sauvage. Mais il montra surtout combien l’approche limitée des rapports sociaux et économiques révélait leur ignorance totale des véritables racines de la crise écologique actuelle.
Dans la logique de certains des partisans les plus fanatiques de l’Ecologie Profonde (2), l’Homme n’est qu’une erreur de la Nature, un être malfaisant qui ne vit que pour détruire son environnement. Ils jugent l’espèce humaine comme étant par nature criminelle et voient dans les catastrophes naturelles un bon moyen de réguler sa population sur la surface du globe. On en arrive à des déclarations aberrantes comme celle de Dave Foreman, ancien porte-parole de Earth First dans les années 1980, qui certifiait qu’ "il est temps pour cette société guerrière de disparaître de la terre dans un raz-de-marée destructeur qui formera des anticorps contre la vérole humaine qui est en train de ravager cette belle et précieuse planète » , et de poursuivre que les actions de son organisation « n’ont pas pour but de renverser un quelconque système social, politique ou économique » mais de défendre les espaces encore sauvages du nord-américain. Le rejet de leur propre nature humaine les conduit à créer une opposition non fondée entre l’Homme et son environnement (recréant paradoxalement la distinction Homme/Nature biblique). Cette incapacité aveugle et torturée à distinguer ce qui est profondément anti-écologique dans le capitalisme empêche de voir ce qui pourra être profondément écologique dans une société qui en serait enfin libérée.
Le manque d’un véritable projet social dans l’Ecologie Profonde, montre l’absence d’une analyse rationnelle et cohérente de la crise écologique que nous traversons. Des visions éco-utopiques coexistent dans la plupart des publications ou sites Internet éco-radicaux avec des perspectives ultra autoritaires à faire frémir (3). Il n’est pas étonnant que se soient diffusées au sein de cette mouvance les thèses primitivistes (voir par exemple le livre de John Zerzan, « Futur Primitif », chez l’éditeur « A Coteaux Tirés ») d’un retour au modèle des chasseurs-cueilleurs pour succéder à la fin de notre civilisation.
L’Ecologie Sociale, sous l’influence du municipalisme libertaire de Pierre Kropotkine (4), tente de dépasser ces limites. Elle recherche la création d’une société basée sur des rapports sociaux non hiérarchiques, reposant sur des communautés démocratiques et autogestionnaires décentralisées. Elle insiste sur la nécessité du développement d’écotechnologies comme les énergies propres, l’agriculture organique et les industries à échelle humaine. Elle prône une décentralisation de la production et une désurbanisation pour redonner le contact de la nature à l’Homme. Le but étant de permettre de retisser un lien entre les hommes et de redonner naissance à une sensibilité écologique dans notre culture, ce projet ne pouvant s’accomplir qu’en combattant la logique de recherche du profit du capitalisme. C’est sur ce point que l’Ecologie Sociale converge avec notre point de vue Socialiste Révolutionnaire. Particulièrement lorsqu’ elle est à l’origine d’actions concrètes conciliant les deux approches écologistes, à la manière des activistes de l’Earth First s’alliant à des bûcherons dans le but de sauver des forêts anciennes du Grand Nord américain, en remplaçant les grandes entreprises forestières par des coopératives appartenant aux travailleurs et soucieuses de l’environnement.
Bien souvent plus radicale dans sa logique que l’Ecologie Profonde, l’Ecologie Sociale n’arrive pourtant pas à se débarrasser de certaines des illusions en vogue dans les milieux de Gauche ( recherche de contacts avec les institutions, alter mondialisme, citoyennisme). Mais elle pose pourtant une bonne question : comment le développement social peut- il s’intégrer harmonieusement à l’environnement ?
Notes :
1) Les Industrial Workers of the World est une organisation syndicaliste-révolutionnaire américaine qui mena la vie dure aux grands patrons par sa pratique systématique de l’action directe au début du 20° siècle.
2) Une partie de la base des organisations écologiques radicales (mais aussi les défenseurs des droits des animaux type ALF) est formée par les générations de citadins qui ont perdu tout contact avec la nature et qui ont une représentation fantasmatique de la Nature Sauvage. Cette ignorance des réalités de l’environnement a ainsi abouti en Angleterre à ce que les visons libérés des fermes d’élevage par l’ALF deviennent des prédateurs dangereux pour la faune locale.
3) Sont ainsi nées des organisations qui œuvrent pour l'extinction du genre humain. Ce qui nous est prouvé par la constitution récente de VHEMT (The Voluntary Human Extinction Movement) publiant sur Internet une quarantaine de pages contenant des arguments sérieux pour nous persuader que la race humaine doit s'éteindre volontairement par l’auto-stérilisation.
4) Pierre Kropotkine est issu de l'une des plus vieilles familles de la noblesse russe. Progressivement rallié au camp révolutionnaire, il voyage en Europe de l’Ouest. Arrivé à Zurich, il adhère à une section de l'Association internationale des travailleurs (AIT) proche de la tendance libertaire. De retour en Russie, Kropotkine devient un propagandiste infatigable et, durant deux ans, il parcourt les quartiers populaires de Saint-Pétersbourg déguisé en paysan, sous le nom de Borodine. Revenu en Suisse, il déploya toute son énergie au service de la cause révolutionnaire, traversant l’Europe pour soutenir toutes les initiatives. Kropotkine publiera de nombreux ouvrages où sont exposés les principes de la société anarchiste: notamment Paroles d'un révolté, la Conquête du pain, l’'Anarchie dans l'évolution socialiste, les Prisons, la Morale anarchiste, la Grande Révolution, les Temps nouveaux, etc. Retourné en 1917 en Russie, il refusera les honneurs et un poste de ministre proposés par Kerenski. Il ne cesse de dénoncer la dictature qui s'instaure à la suite de la prise de pouvoir par Lénine et sera en butte à des tracasseries de la part des bolcheviks jusqu'à sa mort. Il est l’un des penseurs dont peut s’inspirer l’Ecologie sociale dans la mesure où il montra dans un de ses livres L’entraide, l’importance de la coopération pour la survie au sein des communautés animales (et aussi humaines évidemment) fondant ses remarques sur les observations du naturaliste qu’il fut, également. Sa théorie vient tempérer la doctrine darwinienne de la lutte pour la vie dont on sait qu’elle fut également exploitée dans une optique de politique libérale.
Bibliographie :
Quelle Ecologie Radicale ? Débat entre M Bookchin et D. Foreman, Atelier de Création Libertaire.
Murray Bookchin - Qu’est que l’Ecologie Sociale ? - ACL
08:35 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : murray bookchin, ecologie sociale, ecologie profonde | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
26/08/2014
Au coeur du Labyrinthe ... CORNELIUS CASTORIADIS

Intellectuel atypique, Cornelius Castoriadis , disparu à la fin de l'année 1997, avait tenté de cerner la modernité occidentale et de repenser le projet révolutionnaire à l'heure de la dernière des mutations du Capitalisme. Se fondant sur la richesse d'une approche pluridisciplinaire, basée sur une connaissance hors norme des divers domaines de la pensée (sociologie, philosophie, économie, histoire, psychologie), il avait façonné une théorie qu'il voulait en perpétuelle évolution. Jusqu'à présent peu connu du grand public, elle tend à être justement redécouverte au sein des divers mouvements contestataires.
Penser la modernité occidentale
Né en Grèce en 1922, il s'engage dès sa jeunesse au sein du Parti Communiste de son pays. Refusant l'alignement sur Moscou, le jeune étudiant rejoint ce qui lui semble être la seule opposition révolutionnaire au stalinisme : le trotskisme. Après guerre, il émigre en France et fonde une tendance au sein de la section française du Parti Communiste International. L'observation de la réalité sociale et des cénacles sclérosés de l'extrême gauche lui font comprendre les limites de cette mouvance. Jugeant indispensable une nouvelle appréciation de l'évolution de l'économie capitaliste et des orientations du Mouvement Ouvrier, il co-fonde en 1949 avec Claude Lefort le groupe/revue Socialisme ou Barbarie. La rupture est complète avec le trotskisme et la critique du stalinisme est radicale. Socialisme ou Barbarie insistera particulièrement sur le fait que les sociétés à l'Est comme à l'Ouest du Mur étaient dominées par deux variantes du même régime social : le Capitalisme Bureaucratique et le Capitalisme libéral.
La critique du bureaucratisme à l'Est est connue et nous ne reviendrons pas dessus, vu que ce système a actuellement disparu. Plus intéressante (et surtout à l'ordre du jour) est la réflexion de « Castor » sur l'évolution du monde occidental à l'heure de la domination totale de l’Economie. L'après-guerre est marquée pour Cornélius Castoriadis par l'émergence de la bureaucratisation de la société et la privatisation des individus : « la consommation pour la consommation dans la vie privée et l’organisation pour l’organisation dans la vie publique. ».
La bureaucratisation de la société correspond à la prise en main par les « spécialistes », les « experts » et les « technocrates » de la direction de l'ensemble des activités collectives. Cet appareil impersonnel est rigoureusement et hiérarchiquement organisé pour ne laisser aucune place à l'autodétermination populaire. Cette dépossession de la capacité de choisir son destin s'accompagne de la privatisation des individus. C'est le retrait dans la sphère privée, le désintérêt pour toutes les formes d'activité sociale et de la chose publique. Ces deux aspects marquants de nos sociétés, Castoriadis les analyse comme la capacité du capitalisme à exploiter et intégrer, en même temps, de larges franges de population. Par ce processus complexe, par le confort, la consommation, les loisirs, le conformisme, le système capitaliste, ce « cauchemar climatisé », réussit à gagner la servitude volontaire, l’adhésion du peuple, tout en l’exploitant : « L’aliénation croissante des hommes dans le travail est compensée par « l’élévation du niveau de vie » ». Mais dans cette société, le revenu n’a guère « de signification que par la consommation qu’il permet », et celle-ci tend à n'être que la satisfaction de besoins artificiels fabriqués par les industriels et les publicistes. Du social au politique, on retrouve l'impossible logique du capitaliste : solliciter la participation mais interdire toute initiative en dehors des normes du système. Elle forge un individu « défini par l’avidité, la frustration, le conformisme généralisé, (...) la fuite dans la consommation, (...) le fatalisme, (...) perpétuellement distrait, zappant d’une « jouissance » à l’autre, sans mémoire et sans projet, prêt à répondre à toutes les sollicitations d’une machine économique qui de plus en plus détruit la biosphère de la planète pour produire des illusions appelées marchandises ». Un être incapable de se prendre en mains, entièrement déresponsabilisé.
Castoriadis détaille (dès les années 1960) la très nette séparation entre la vie privée des individus et la vie publique de la société. Ces deux vies, ces deux sphères se mêlent peu, les individus ne se préoccupent que de leur routine et laissent leurs représentants politiques se débrouiller entre eux : « La chose publique ou plus exactement la chose sociale est vue non seulement comme étrangère ou hostile, mais comme échappant à l’action des hommes ». « Les « oligarchies libérales » contemporaines - nos « démocraties » - prospèrent sur ce renoncement.
Castoriadis parle en définitive de la décomposition de notre société, qui se voit surtout dans la disparition des significations, l’évanescence presque complète des valeurs : « La seule valeur qui survit est la consommation. ». On est bien dans une société qui se désintéresse de plus en plus de la « politique » - c’est-à-dire de son sort en tant que société- et qui privilégie l'Economie. Cette crise est liée pour Castoriadis à « l’effondrement de l’auto-représentation de la société », à une absence de projet, d’horizon, à une « inhibition de la puissance de création ». Dans ce huis clos historique, les contraintes qui paralysent l’imagination et l’activité politiques rendent possibles les régressions vers la « Barbarie ». Et le « Socialisme » dans tout cela ?
Redéfinir le projet révolutionnaire
Socialisme ou Barbarie a eu un rôle fondamental dans l'émergence d'une nouvelle critique du capitalisme. Mais en 1967, l'organisation va s'autodissoudre à la suite de désaccords internes sur l'orientation stratégique à suivre. Pour sa part, Castoriadis poursuit sa réflexion de manière indépendante et non dogmatique. S'interrogeant sur l'actualité du projet révolutionnaire, il est amené à redéfinir les apports de l'héritage du mouvement ouvrier.
Sa « rupture » avec le Marxisme est d'abord une réaction contre les interprétations arides et erronées de certains des zélateurs, alors à la mode, de l'auteur du Capital. Mais c'est surtout la prise de conscience d'une faille au sein de la réflexion du philosophe allemand. Par son culte du rationalisme scientifique, Marx, a pour lui, fait l'erreur de croire que des règles définitives pouvaient expliquer l'ensemble des mécanismes sociaux. Ce faisant il rejoint les théories capitalistes et déterministes de la rationalité économique, où l’économique est un système prédominant, séparé du reste des relations sociales, et où il constitue la seule motivation de l’agir humain. Le marxisme reste donc ancré dans l’optique capitaliste, ce qui rend d’autant plus facile sa récupération (par exemple par la social-démocratie). Il faut donc rompre avec « l'économisme » et sa logique déterministe.
Mais sa critique de Marx ne se traduit pas par un reniement du projet révolutionnaire ou par un ralliement à la démocratie libérale. Au contraire, c'est la volonté de redonner tout son sens à la perspective émancipatrice et révolutionnaire qui va animer sa réflexion. La nouvelle situation, la domination sans partage du Capitalisme, exige une nouvelle pensée radicale. Elle conserve l'essence initiale de la pensée politique de Marx : la réintégration du théorique dans la pratique historique. C'est-à-dire ne plus interpréter le monde, mais le transformer.
Pour Castoriadis, l’avènementd’une société autonome passe par une révolution. Mais pour lui, la révolution n’est pas seulement un moment ponctuel et brutal, ni n’ouvre d’un coup les portes d’une ère paradisiaque. La révolution est surtout un processus, qui peut prendre du temps, où l’autonomie, le socialisme sont déjà mis en pratique, et qui remet en question la société dans sa globalité. Pourquoi nous faut-il une révolution pour changer la société ? Castoriadis insiste sur l’aspect global de notre société : tout s’y tient, l’aliénation concerne tous les domaines de la vie, l’économie, la culture, etc. La critique de la société doit « s’élargir à tous les aspects de la vie moderne ». Et le renversement de cette société, par conséquent, ne peut être que total.
Les formes d'un tel bouleversement ? « S’agissant des formes d’organisation et d’action de la population, l’idée centrale consiste à concurrencer et marginaliser les partis politiques moyennant la création et la mise en oeuvre par la population d’organes collectifs autonomes et démocratiques. » Castoriadis parle de « l’autonomie du prolétariat : (...) ce dernier doit parvenir à la conscience socialiste que dans et par son expérience propre ». L'émancipation des travailleurs sera donc l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes. La différenciation entre dirigeant et dirigé devant être abolie par l'action collective qui trouve sa forme la plus aboutie dans l'idée moderne des conseils ouvriers. Plus largement que l'unique prolétariat, elle concerne l'ensemble des femmes et des hommes qui subissent le système.
« Le Socialisme, écrit-il, ne peut être ni le résultat fatal du développement historique, ni le viol de l'histoire par un parti de surhommes, ni l'application d'un programme découlant d'une théorie vraie en soi – mais le déclanchement de l'activité créatrice libre des masses opprimés, déclenchement que le développement historique rend possible et que l'action d'un parti basé sur cette théorie peut énormément faciliter ».
Castoriadis définit le Socialisme comme la volonté d'instaurer une société caractérisée par la maîtrise consciente des hommes sur leur existence, leur activité et leurs produits : « Le Socialisme vise à donner un sens à la vie et au travail des hommes, à permettre à leur liberté, à leur créativité, à leur positivité, de se déployer, à créer des liens organiques entre l’individu et son groupe, entre le groupe et la société, à réconcilier l'homme avec lui-même et avec la nature ».
Le projet d'autonomie
L'oeuvre de Cornélius Castoriadis s'est construite sur cette interrogation politique cruciale : « Comment les hommes peuvent-ils devenir capables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes ? ».
Il trouvera un début de réponse dans l'élaboration du projet d'Autonomie (I). La lutte contre l'aliénation, contre l « hétéronomie » devient une lutte pour l'autonomie. C'est-à-dire la capacité consciente des humains à être entièrement maîtres de leur vie, de leur société, des institutions qu’ils se donnent. Le noeud de cette question d’autonomie et d’hétéronomie, c’est l’idée que toute société humaine, toute institution, a été créée par les humains, relève du domaine de l’humain, et peut être changée. Il s’agit pour les humains de comprendre que leur société leur appartient, qu’elle ne fonctionne que par leur participation plus ou moins forcée, qu’ils peuvent se la réapproprier.
Les pays occidentaux vantent leur modèle de « démocratie » et le présentent comme un aboutissement des idéaux humanistes. Mais soyons clairs : notre « démocratie » n’est qu’une démocratie représentative, loin du « pouvoir du peuple » que devrait pourtant désigner son nom même. Face à notre modèle de démocratie représentative, Castoriadis propose celui de démocratie directe, « que caractérisent trois traits essentiels : le peuple par opposition aux « représentants », le peuple par opposition aux « experts », la communauté par opposition à « l’Etat ». ». Dans la démocratie directe, selon le principe d’autonomie, chaque loi est décidée directement et collectivement par toutes les personnes auxquelles elle s’applique, « en sorte que l’individu puisse dire, « réflexivement et lucidement, que cette loi est aussi la sienne ». L’autonomie suppose donc « un état dans lequel la question de la validité de la loi reste en permanence ouverte. ». C’est ce questionnement politique même, collectif, lucide, délibéré et continuel, qui importe : Castoriadis l’associe à la philosophie et à « la vérité comme mouvement interminable de la pensée mettant constamment à l’épreuve ses bornes et se retournant sur elle-même (réflexivité) ». Castoriadis affirme donc que nous ne pouvons nous reposer sur aucune certitude, aucun principe absolu, pour justifier nos choix de société. Il rappelle que toute la responsabilité d’un choix politique revient à l’homme, que ce choix ne dépend que de lui, qu’il doit en être conscient et assumer cette responsabilité.
Cette idée de responsabilité doit aboutir à une auto-limitation librement consentie. Au sein de la société autonome, rien ni personne d’autre que leur propre conscience, leur propre éthique, leur propre réflexion ne doit limiter la créativité des hommes.
Pour mettre en place la démocratie directe, il nous faudra bien sûr abandonner la démocratie actuelle et changer nos institutions, mais il faudra aussi et surtout changer les mentalités. « Si [les citoyens] ne sont pas capables de gouverner- ce qui reste à prouver -, c’est que « toute la vie politique vise précisément à le leur désapprendre, à les convaincre qu’il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Il y a donc une contre-éducation politique. Alors que les gens devraient s’habituer à exercer toutes sortes de responsabilités et à prendre des initiatives, ils s’habituent à suivre ou à voter pour des options que d’autres leur présentent. Et comme les gens sont loin d’être idiots, le résultat, c’est qu’ils y croient de moins en moins et qu’ils deviennent cyniques (...) Les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires ». » Les humains doivent cesser de considérer la politique comme un domaine séparé et spécialisé, et doivent apprendre à la voir « comme un travail concernant tous les membres de la collectivité concernée, présupposant l’égalité de tous et visant à la rendre effective ». Le projet de société autonome peut paraître une belle utopie, abstraite et idéale... Mais Castoriadis rappelle que ce projet, ce rêve existe depuis des centaines et des milliers d’années, depuis qu’on a commencé à parler de Démocratie dans la Grèce antique. Il implique « une mutation anthropologique ».
Cars construire une société révolutionnaire ne signifie pas simplement changer les structures administratives, les institutions ou l’appareil de production... Cela signifie changer de valeurs, de mœurs, de morale, de mentalité : « C’est seulement au niveau culturel qu’une politique de la liberté peut s’ancrer profondément et durablement, et par conséquent être investie par les individus. ». C'est par l'éducation, ce qu'il l’appelle « païdeia », « La païdeia, l’éducation-socialisation, (...) a pour fonction d’incarner et transmettre la conception (...) du bien commun ». En effet, comme dans toute société, l’éducation, la socialisation, l’acculturation, fait le lien entre chaque individu et l’ensemble de la société, entre le domaine intime, personnel et le domaine collectif des structures sociales. Castoriadis fait justement de la païdeia « l’institution la plus radicale, centrale et fondamentale du projet d’autonomie ».
NOTE
1 - Un peu d’étymologie... Auto = le même, hétéro = l’autre, nomos = la loi, donc autonomie = exécuter des lois qu’on se donne soi-même (« sachant qu’on le fait » ajouterait Castoriadis), hétéronomie = exécuter des lois données par d’autres.
BIBLIOGRAPHIE
Oeuvre de Castoriadis
L'institution imaginaire de la société – Le Seuil - 1975
Les Carrefours du labyrinthe – Le Seuil - 1978
La Montée de l'insignifiance - Le Seuil - 1996
Une société à la dérive, entretiens et débats 1974-1997 – Le Seuil - 2005
Sur la pensée de Castoriadis
Gérard DAVID, Cornélius Castoriadis : le projet d'autonomie – Michelon – 2000
L'étude la plus complète sur sa pensée politique. Indispensable pour comprendre son engagement.
Nicolas POIRIER, Castoriadis : l'imaginaire radical – PUF – 2004
Une approche plus philosophique.
20:28 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cornelius castoriadis, autonomie, socialisme | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
19/08/2014
Aperçu sur l'idée d'ordre politique dans la philosophie européenne par Jean Galié
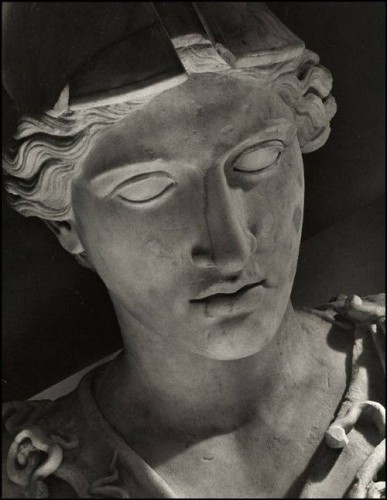
La politique a pour fonction de s’occuper du politique, de la chose politique, c’est-à-dire de ce qui concerne l’ensemble des citoyens ou la vie collective de la cité. Mais dans quel but?
Une réponse classique se tourne vers l’idée de Bien commun. Aussi faut-il retenir cette idée que le Bien est notre but. C’est le Souverain Bien, bon en lui-même, par rapport auquel tous les autres ne sont que moyens. Il est le but de toute activité dans le monde. “N’est-il pas exact que, par rapport à la vie humaine, la connaissance de ce bien a une importance considérable et que, la possédant, comme des archers qui ont sous les yeux le but à atteindre, nous aurons des chances de découvrir ce qu’il convient de faire?” (1)
La recherche de ce bien sera conduite par une science : “science souveraine et au plus haut point organisatrice. Apparemment, c’est la science politique.” (2) Aristote nous plonge au coeur des relations entre la morale et la politique. Selon sa conception eudémoniste, le bonheur est la fin suprême de la vie. Mais comme l’homme est un “animal politique” sa vraie nature ne pourra s’accomplir que dans la cité. Celle-ci est “née en quelque sorte du besoin de vivre, elle existe pour vivre heureuse. C’est pourquoi toute Cité est dans la nature.” (3)
Aristote distingue bien le bonheur de chacun du bonheur de l’ensemble de la vie collective. Le premier s’identifie à l’activité de contemplation dans la mesure où en tant qu’esprit, l’homme pourra cultiver cette partie de l’âme le rapprochant du divin.
Le loisir, période de temps échappant à l’empire de la nécessité et des activités en relation avec celle-ci (travail, économie, etc) s’identifie au bonheur personnel. Néanmoins sa condition de possibilité réside dans le bien de l’Etat. Ce dernier à son tour permet par son existence d’actualiser les capacités et les facultés spirituelles et morales de l’homme. Le but de la politique n’est pas la morale mais de rendre possible l’existence de celle-ci. C’est en ce sens que la morale dépend de la politique et non au sens où cette dernière dicterait les fins de la morale (tentation de la Pensée Unique contemporaine...). Pas plus qu’il ne s’agira de résorber le bonheur individuel dans un hypothétique bonheur collectif. “Même si le bien de l’individu s’identifie avec celui de l’Etat, il paraît bien plus important et plus conforme aux fins véritables de prendre en mains et de sauvegarder le bien de l’Etat. Le bien, certes, est désirable quand il intéresse un individu pris à part ; mais son caractère est plus beau et plus divin quand il s’applique à des Etats entiers.” (4)
Aux antipodes de l’individualisme moderne, c’est en ce sens que s’impose l’idée d’un Bien commun. Mais cette idée, bien que raisonnable pour le sens commun, ne saurait se fonder elle-même. Pour les Anciens, la Nature était l’Ordre du monde, la loi innervant le kosmos, chaque chose tendant naturellement à son épanouissement conformément à cette loi ; ainsi de la nature de l’homme se conformant à l’ordre de la cité. De même, c’est pour cette raison que la “cité est dans la nature”.
Le politique trouve en réalité son fondement dans la métaphysique, autrement il serait incompréhensible que le politique soit le lien de manifestation des facultés spirituelles de l’homme. “Le fondement premier de l’autorité et du droit des rois et des chefs, ce grâce à quoi ils étaient obéis, craints et vénérés, était essentiellement, dans le monde de la Tradition, leur qualité Transcendante et non uniquement humaine (...) La conception purement politique de l’autorité suprême, l’idée qu’elle a pour fondements la force brutale et la violence, ou bien des qualités naturalistes et séculières, comme l’intelligence, la sagesse, l’habilité, le courage physique, la sollicitude minutieuse pour le bien commun matériel - cette conception fait totalement défaut dans les civilisations Traditionnelles, elle n’apparaît qu’à des époques postérieures et décadentes”. (5)
C’est dans ce contexte de pensée qu’il est possible de lire les doctrines politiques des Anciens dont quelque chose - l’essentiel - se transmettra jusqu’au Moyen-Age, pour lequel le pouvoir temporel était une délégation de l’autorité divine. Pour Platon, par exemple, la politique tend à pérenniser une stabilité quasi ontologique. La science du Politique vise à contenir l’usure exercée par le temps sur tout ce qui est éphémère, et en particulier sur une juste hiérarchie établie dans la Cité et à l’intérieur des diverses instances de l’âme humaine.
Dans son dialogue “le Politique”, Platon rapporte le mythe selon lequel, dans un temps originel - celui de Cronos - toute chose fonctionnait en sens inverse de celui de l’ordre actuel, c’est-à-dire dans le sens originel. Cet ordre s’appliquait aussi bien aux cycles astronomiques qu’aux cycles vitaux,ainsi l’homme rajeunissait tout au long de sa croissance. Le temps de Cronos a laissé place à celui de Zeus qui renverse l’ordre originel pour faire place à un ordre inversé avec lequel nous devons composer, éloignés que nous sommes du temps mythique des origines. L’homme archaïque vit dans un univers protégé dont le sens lui est naturellement acquis. “L’attitude mythique - naturelle comprend d’avance et d’emblée non seulement des hommes et des animaux, et d’autres êtres infra-humains et infra-animaux, mais aussi des êtres surhumains. Le regard qui les englobe comme un tout est un regard politique”. (6)
En d’autres termes, le destin de l’homme y dépend de la manière dont règnent ces puissances mythiques au sein d’un cycle où se perpétue l’éternel retour de la configuration initiale de l’ordre des choses, assurant ainsi un retour perpétuel du même dans un monde qui vieillit jamais, ne subissant pas l’érosion du temps historique (7).
Platon connaît bien la Tradition. Pour lui, la politique consistera à garder son regard porté sur le modèle Transcendant instituant l’ordre de la Cité juste, cette cité idéale décrite dans “La République” obéissant à la loi d’équilibre situant chaque catégorie de citoyens à la place correspondant à ses qualités intrinsèques, du Roi au producteur en passant par le guerrier. Cette loi est l’axe ontologique grâce auquel une telle hiérarchie est rendue légitime, faute de quoi chaque forme de gouvernement sera susceptible de dégénérer, la monarchie régressant en timocratie (gouvernement de l’honneur), celle-ci en oligarchie (petit nombre), cette dernière en démocratie (tous) dont le sort ultime sera la tyrannie. De la perfection à la confusion des pulsions inférieures de l’âme humaine, de la loi à l’informe. “ Spécialement dans les formulations aryennes, l’idée de loi est intimement apparentée à celle de vérité et de réalité, ainsi qu’à la stabilité inhérente “à ce qui est”. Dans les Védas, rta signifie souvent la même chose que dharma et désigne non seulement l’ordre du monde, le monde comme ordre - kosmos -, mais passe à un plan supérieur pour désigner la vérité, le droit, la réalité, son contraire, anrta, s’appliquant à ce qui est faux, mauvais, irréel. Le monde de la loi et, par conséquent, de l’Etat, fut donc l’équivalent du monde de la vérité et de la réalité au sens éminent”. (8)
Pour Platon et ses successeurs au sein de la philosophie politique classique, la science politique a donc pour fonction d’imposer une “forme” métaphysique au chaos toujours possible et resurgissant, en incarnant une idée de stabilité et de justice propre à l’ordre traditionnel qui avait trouvé son expression initiale dans le système des castes dont l’homme moderne ne peut saisir le sens et la portée spirituels. Tel a été l’univers mental indo-aryen, et dont Georges Dumézil a longuement déchiffré les structures idéologiques. Ainsi chez Platon ordre et hiérarchie sociale reflètent-ils un ordre et une hiérarchie internes à l’âme humaine. Les ordres de citoyens correspondent à des puissances de l’âme et à certaines vertus. Aux chefs de la cité, les magistrats, archontes correspondent l’esprit, noûs et la tête ; aux guerriers l’animus et la poitrine ; aux producteurs, la faculté de désir, partie concupiscible de l’âme et la partie inférieure du corps, sexe et nourriture.
Les castes, les catégories de citoyens, les ordres définissaient des modes typiques d’être et d’agir, de la matérialité à la spiritualité. Platon s’était donné pour objectif politique d’instituer par l’éducation un plan de sélection des élites capable de conduire la Cité. Tel homme appartient à telle catégorie de citoyens non pas à cause de conditions arbitraires mais parce que le caractère de son âme - décelé par les magistrats ou les éducateurs - le destine à remplir telle ou telle fonction, selon la symbolique de l’âme au caractère d’or, à celle d’argent, d’airain ou de fer, dans un ordre de valeur décroissant ; de la capacité de commandement éclairé à celle de fidélité d’exécution.
Que reste-t-il de ce bel édifice conceptuel et métaphysique dans la pensée politique moderne?
Peu de choses, depuis que Machiavel (1469-1527) a rompu avec la philosophie politique classique, dont celle du Moyen-Age qui pensait le politique en se référant à Saint Augustin pour qui la “cité terrestre” se distinguait, tout en la reflétant, de la “cité céleste”. Dans les conditions d’existence, marquées du sceau du péché originel, l’Etat se devait d’être le soutien et le glaive de l’autorité spirituelle. Cela n’allant d’ailleurs pas de soi, puisque dans les faits - querelle des Guelfes et des Gibelins - il s’agissait de savoir qui de l’Empereur ou du Pape incarnait au mieux cette idée d’autorité spirituelle, cette dernière ne devant pas se dégrader en simple pouvoir temporel.
Machiavel, lui, a desacralisé la politique, il en fait un simple instrument humain, profane, elle n’est plus ordonnée à une fin supérieure, transcendante. La question est de savoir comment prendre le pouvoir et le conserver. L’essentiel est la stabilité de l’Etat, ce qui est une redondance puisque “Lo Stato” est ce qui tient debout.
En soi, l’homme de pouvoir, le Prince n’est pas immoral, mais il doit savoir mener les hommes et jouer des circonstances. Se faire “renard” ou “lion” selon le cas où primera la ruse ou la force, se faire tour à tour aimer et craindre, sachant qu’il n’est pas totalement maître de
l’histoire puisque celle-ci pour moitié peut se laisser guider par sa “virtù”, puissance et virtuosité, et pour autre moitié est “fortuna”, à l’image du fleuve impétueux dont on ne peut arrêter le cours mais seulement l’endiguer.
En ce sens la grande découverte de Machiavel est que la politique est un artifice. Telle est l’essence de la conception moderne de la politique, qui, historiquement verra toujours subsister à ses côtés la conception classique, et se développera selon cet axe de l’artifice pensé rationnellement, par un calcul, et dont les théories du contrat seront très largement tributaires.
Dès lors, l’ordre politique est essentiellement humain, dérivé de l’accord, du pacte d’obéissance qu’un peuple passe avec son Souverain. L’autorité de ce dernier n’est plus réputée être naturelle, ainsi chez ces libellistes appelés monarchomaques au 16ème siècle, contestant l’autorité du Roi. Souvent protestants - parfois catholiques - ils justifient leur rébellion en rejetant un ordre politique jugé comme étant illégitime.
C’est dans ce contexte que sera pensé le concept de Souveraineté et discutée la question de la légitimité de l’institution politique. Si l’idée de Souveraineté existe depuis l’Antiquité puisqu’elle est inhérente à toute forme d’exercice du commandement politique, la conceptualisation qu’en fait Jean Bodin (1520-1596) sera reprise dans la philosophie politique moderne.
Dans les “Six livres de la République” il la définit comme “puissance absolue et perpétuelle d’une république”. C’est ainsi qu’une nation se constitue en Etat, s’identifie à celui-ci. La Souveraineté devient puissance absolue fondant la République, c’est son âme même. Le lien unissant un peuple à son gouvernement réside dans la loi, le Souverain fait les lois, la puissance de gouverner s’identifie au pouvoir de légiférer. De ce fait le prince sera au-dessus des lois, idée reprise ultérieurement au 17ème siècle par Hobbes pour qui le Souverain ne saurait être soumis à la loi. Si le Souverain ne peut plus être fondé par le recours immédiat à la transcendance, il est néanmoins resacralisé sous une forme profane dans la figure de la souveraineté absolue de l’Etat : “tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’Etat sont des concepts théologiques sécularisés” (Carl Schmitt).
L’autre volet de la discussion repose sur la théorie du contrat. Ce dernier s’enracine dans la doctrine du droit naturel. Envisagé du point de vue de la légitimité des fondements de l’Etat, comme artifice produit par l’homme, le droit naturel est conçu soit comme droit de la force, soit comme droit idéal.
Le première conception est représentée par Hobbes et Spinoza. A l’état de nature - fiction idéologique - règne un droit de nature défini “par le désir et la puissance” (Spinoza), comme étant “le droit de chaque homme de faire ou de posséder tout ce qui lui plaît” (Hobbes). Rien n’y est injuste ou juste avant l’établissement de la loi civile. Pour Hobbes, l’état d’insécurité résultant de l’exercice du droit naturel (“guerre de chacun contre chacun”) pousse l’homme, par une loi naturelle inhérente à l’être de raison qu’il est, à faire un calcul afin de quitter cette situation. Ce sont les termes du contrat, du pacte qui fait disparaître cette situation arbitraire (analogue à la guerre civile, ou au désordre régnant à l’intérieur de certains Etats...) afin d’établir un Etat rationnel.
L’idée d’un droit naturel “idéal” est représentée par l’Ecole du droit naturel au 17ème siècle. Elle a servi de base à ce qu’on a appelé Droit des Gens. Ainsi le philosophe et juriste hollandais Grotius (1583-1645) dit que le droit naturel émane de la nature sociale de l’homme : c’est d’elle que la raison humaine, observant les diverses pratiques, dégage les principes d’un droit universel, immuable. Il est distinct du choix volontaire, arbitraire.
Il peut cependant être rattaché au droit divin “puisque la divinité a voulu que de tels principes existassent en nous” (Grotius). Cependant, cette distinction atteste un passage de l’ordre de la Providence à celui de l’humanité. C’est un droit rationnel. Cette doctrine peut aboutir sur une vision individualiste - Locke pense que les hommes à l’état de nature sont libres, égaux, éclairés par la raison, peuvent donc respecter les préceptes du droit naturel ; l’organisation politique n’étant nécessaire que pour préserver les prérogatives naturelles de l’homme (liberté, égalité, propriété), vision anarcho-libérale - ou bien sur un humanisme rationnel (Kant) pour lequel la raison triomphe à travers une légalité propre à régir les peuples libres, car le droit est la notion se dégageant des conditions dans lesquelles la faculté d’agir d’autrui d’après une “loi universelle de liberté”. Kant défendra grâce à cette théorie, l’idée problématique d’une Société des Nations à partir d’un point de vue cosmopolitique.
Poussée à l’extrême la thèse d’un droit naturel idéal débouche sur la conception d’un idéal de justice existant au-dessus du droit positif. “Il existe un Droit universel et immuable, source de toutes les législations positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne les hommes” (Avant-projet du Code Civil de l’An VIII). Le droit naturel a pour but la protection de ces droits imprescriptibles qui sont, aux termes de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 : liberté, propriété, sûreté et résistance à l’oppression.
Mais que dire si le Droit universel s’incarne adéquatement dans la loi positive, si ce n’est celui qui dispose de la puissance inhérente à cette loi. Cette théorie se traduit en particulier dans ce que Carl Schmitt appelle l’Etat législateur. “L’Etat législateur, à cause de la rigueur de son système de légalité, ne peut pas admettre la coexistence de plusieurs sources de droit, comme en droit romain, les lois, les plébiscites, les sénatus consultes ou les constitutions impériales, les édits de magistrats, les réponses des “prudents”, etc” (9)
Cet universalisme abstrait n’est pas sans dangers, et Carl Schmitt de nous mettre en garde : “Si la notion de loi perd un jour toute relation interne avec la raison et la justice et qu’on conserve néanmoins l’Etat législateur avec son sens propre de la légalité, qui concentre dans la loi tout ce qu’il y a de supérieur et de respectable dans l’Etat, - à ce moment-là, n’importe quelle ordonnance, commandement ou mesure..., n’importe quelle instruction à un juge pourra devenir, grâce à une décision du Parlement ou d’une autre instance préposée à l’élaboration des lois, légal et conforme au droit en vertu de la souveraineté de la loi. Le formalisme poussé à l’extrême finit par (...) abandonner ses relations avec l’Etat de droit”. (10)
Ainsi la fameuse “indépendance” des juges ne masque-t-elle pas son contraire, une hégémonie idéologique instrumentalisant le formalisme de la loi? “On suppose qu’en vertu des liens semblables qui rattachent tous les citoyens à un même peuple, tous doivent être, en raison de ces traits communs, essentiellement semblables les uns aux autres. Or, que cette hypothèse, supposant une harmonie nationale parfaite, vienne à disparaître, on verra immédiatement le pur “fonctionnalisme” sans objet et sans contenu, résultant des données de la majorité arithmétique, exclure toute neutralité et toute objectivité.” (11)
Ainsi l’idéologie actuelle de la “citoyenneté” suffit-elle à définir un peuple, à dégager ces “traits communs”, à établir “l’harmonie nationale”? Un simple contrat, formel suffit-il à fonder une identité? Celle-ci n’a t-elle pas été forgée au cours de notre histoire? De là l’amnésie dont les mondialistes veulent frapper tous les peuples et en particulier le nôtre. Avons-nous oublié que les morts gouvernent les vivants (Auguste Comte)? De nos jours, au nom de la loi, il est possible d’éradiquer toute forme d’opposition à “l’Avenir radieux” que nous promet le Nouvel “Ordre” Mondial.
Dans ces conditions le peuple est devenu une notion abstraite, le citoyen n’est plus enraciné au sein d’une identité singulière qui pourrait être vécue à divers niveaux (occitan, français, européen, par exemple).
En France resurgit le débat sur les identités locales, régionales, nationales, avec une remise en question du centralisme jacobin et la discussion sur la question de la Souveraineté. S’il est évident que dans le camp SRE nous ne voulons pas d’une Europe élaborée par les mondialistes, Europe de carton-pâte aux antipodes d’une Europe de la puissance, le débat est plus nuancé en fonction des diverses sensibilités et des stratégies proposées en l’occurrence. De même le débat est faussé sur le plan sémantique lorsqu’il est présenté sous la forme de la dichotomie entre “souverainistes” et “non souverainistes”.
Si l’on n’est pas souverain c’est que l’on est sous la dépendance de quelqu’un d’autre, que l’on existe plus en tant qu’entité politique! Certes, c’est le rêve des mondialistes, mais il est possible de concevoir - grâce au principe de subsidiarité bien appliqué en corrélation avec les forces vives du pays - un emboîtement de divers étages de souveraineté.
A l’opposé de la théorie libérale qui décourage la participation du peuple à la vie publique et qui rejette toute initiative allant à l’encontre des normes juridiques et constitutionnelles du moment, a été formulée une autre conception par Johannes Althusius (1557-1638) adversaire de J.Bodin en philosophie politique. (12)
Le philosophe allemand revient à Aristote, à sa conception de l’homme comme être social, enclin à la solidarité et à la réciprocité. Dans une démarche de type symbiotique, Althusius affirme que la société est première par rapport à ses membres, et se constitue par une série de pactes politiques, sociaux, conclus successivement de la base au sommet, par associations (“consociations”) naturelles, publiques, privées telles que familles, guildes, corporations, cités, provinces, etc. Modèle d’emboîtements allant du simple au complexe. Les individus sont membres de diverses communautés successives et il n’y a pas de contrat entre le souverain qui est le peuple et le prince qui se borne à administrer. Le contrat social est une alliance, communication symbiotique des individus définis par leur appartenance. Il est formé entre les communautés restreintes qui se fédèrent pour former un corps politique plus vaste et un Etat. Le peuple peut déléguer sa souveraineté mais ne s’en dessaisit jamais. Cela permet un respect des identités particulières, dont on rappellera qu’elles n’étaient point admises par Rousseau dans “Du contrat social” (“Il importe donc, pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale, qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat, et que chaque citoyen n’opine que d’après lui”. Livre II, Chapitre III), et qu’elles furent réellement abolies durant la célèbre nuit du 4 août 1789 et empêchées de se constituer par la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 interdisant toute forme d’association entre gens d’un même métier et toute coalition.
Dans le système d’Althusius chaque niveau tire sa légitimité et sa capacité d’action du respect de l’autonomie des niveaux inférieurs, le principe de souveraineté est subordonné au consentement associatif, celle-ci est répartie à des niveaux différents de la vie politique.La clef de voûte du système est le principe de subsidiarité par lequel les décisions sont prises au niveau le plus bas possible grâce à des unités politiques ayant des compétences autonomes substantielles, et en étant représentées collectivement aux niveaux de pouvoir supérieurs. Le niveau local ne délègue au niveau supérieur que les tâches et responsabilités qu’il ne peut accomplir, telles que par exemple les fonctions régaliennes de l’Etat. La Nation serait donc une communauté de communautés.
Encore ne faudrait-il pas interpréter cette idée dans les termes du “communautarisme” véritable juxtaposition de communautés linguistiques, ethniques, religieuses ou autres qui n’auraient en commun qu’une proximité d’ordre géographique et de destin commun que la simple survie économique.
En dernier lieu la question d’un ordre politique et social se résume au fait de savoir qui détient la puissance et pour quoi faire. Aussi un peuple ne doit-il pas ignorer qui il est, quelle est sa nature profonde, quelles sont ses attaches essentielles. Ces thèmes fondamentaux ne sauraient être écartés par l’idéologie éradicatrice des Droits de l’Homme qui désubstantialise tout ce qu’elle touche (13).
Il n’y a rien en effet de plus libre, et de plus facile à promouvoir sur le plan idéologique qu’une forme vide. Il est bien plus difficile de résister à ce courant homogénéisant du mondialisme et de nommer l’identité à laquelle nous devons nous référer pour être nous-mêmes.
Pour autant face au chaos actuel, à la véritable entropie générée par le système mondialiste, notre peuple ne pourra faire l’impasse sur ce choix décisif.
Delenda est Carthago!
Jean Galié
NOTES :
(1) Aristote : Ethique à Nicomaque. Livre I.
(2) idem.
(3) Aristote. Politique
(4) Aristote. Ethique à Nicomaque. Livre I.
(5) Julius Evola. Révolte contre le monde moderne. Editions L’Age d’Homme p.41-42.
(6) Husserl. La crise des sciences européennes en la phénoménologie transcendantale. p.364.
(7) Cf Le mythe de l’éternel retour (Mircea Eliade).
(8) Julius Evola. Révolte contre le monde moderne. p.61.
(9) Carl Schmitt. Du politique. “Légalité et légitimité” et autres essais. p.53. Editions Pardès.
(10) idem p.54.
(11) idem p.60.
(12) Lire à ce sujet l’excellente contribution à ce débat dans le n°96 - novembre 1999, de la revue “Elements”, à laquelle nous empruntons ces informations.
(13) Ainsi, par exemple, la doctrine Monroe conçue sur la base de l’espace concret, transformée par Theodore Roosevelt en principe impérialiste commercial devenant un principe universaliste s’étendant à la Terre entière, et conduisant à l’ingérence de tous en tout. “Alors que, dans l’idée d’espace, il y a celle de limiter et de répartir l’intervention donc un principe de droit et d’ordre, la prétention universaliste à l’ingérence mondiale abolit toute limitation et toute distinction raisonnables” Carl Schmitt. Ouvrage cité, p.127-28. “Le fait que la doctrine de Monroe ait ainsi pu être trahie et transformée en un principe impérialiste commercial demeurera, pour longtemps, un exemple bouleversant de l’effet que peuvent produire des slogans vides” Carl Schmitt, idem p.129.
15:42 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, jean galié, carl schmitt, husserl, alain de benoist, rébellion | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer


 Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net
Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

